 Pour ce 50e numéro, Recherches interroge les continuités et les ruptures dans l’enseignement du français. À l’heure de la suppression programmée des RASED, l’institution multiplie les injonctions et les outils visant à faciliter le suivi de l’élève. Mais qu’en est-il dans la réalité de la classe ? Du point de vue de la discipline d’abord : il s’agit d’interroger l’illusion continuiste que donnent les programmes actuels de la discipline français et de ses objets, en réalité multiformes. La question est abordée également du point de vue des élèves et de leurs acquis, eux aussi fluctuants : comment alors tenir compte de la nécessité de ménager des transitions sans nier les ruptures, elles aussi essentielles – de la maternelle à l’université ? Comment faire en sorte que ces individus, réunis au sein de ce qui est appelé « une classe », se constituent en collectif d’apprentissage ? Qu’en est-il du regard de l’élève ? La question est ensuite envisagée du point de vue de l’enseignant lui-même qui n’est pas épargné par les ruptures dans sa vie professionnelle. Enfin, l’Institution dans son ensemble est en jeu : comment prend-elle en charge les élèves qui sont trop tôt tentés de quitter la classe ?
Pour ce 50e numéro, Recherches interroge les continuités et les ruptures dans l’enseignement du français. À l’heure de la suppression programmée des RASED, l’institution multiplie les injonctions et les outils visant à faciliter le suivi de l’élève. Mais qu’en est-il dans la réalité de la classe ? Du point de vue de la discipline d’abord : il s’agit d’interroger l’illusion continuiste que donnent les programmes actuels de la discipline français et de ses objets, en réalité multiformes. La question est abordée également du point de vue des élèves et de leurs acquis, eux aussi fluctuants : comment alors tenir compte de la nécessité de ménager des transitions sans nier les ruptures, elles aussi essentielles – de la maternelle à l’université ? Comment faire en sorte que ces individus, réunis au sein de ce qui est appelé « une classe », se constituent en collectif d’apprentissage ? Qu’en est-il du regard de l’élève ? La question est ensuite envisagée du point de vue de l’enseignant lui-même qui n’est pas épargné par les ruptures dans sa vie professionnelle. Enfin, l’Institution dans son ensemble est en jeu : comment prend-elle en charge les élèves qui sont trop tôt tentés de quitter la classe ?
Le numéro est en vente sur notre site. Les articles sont téléchargeables sur cette page.
Sommaire
![]() Le français d’une classe à l’autre / B. Daunay 9
Le français d’une classe à l’autre / B. Daunay 9
![]() Construire une classe / M.-M. Cauterman, F. Darras, M.-P. Vanseveren 27
Construire une classe / M.-M. Cauterman, F. Darras, M.-P. Vanseveren 27
![]() Impromptu, scènes du cours de français / M. Constant 37
Impromptu, scènes du cours de français / M. Constant 37
«![]() Cette année j’entre au lycée… » / S. Dziombowski 43
Cette année j’entre au lycée… » / S. Dziombowski 43
D![]() u lycée professionnel à la classe spécialisée : itinéraire d’un enseignant d’une classe à l’autre… / D. Gorgeret 55
u lycée professionnel à la classe spécialisée : itinéraire d’un enseignant d’une classe à l’autre… / D. Gorgeret 55
U![]() n romancier classique d’une classe à l’autre : les extraits de Balzac dans les manuels scolaires / N. Denizot 59
n romancier classique d’une classe à l’autre : les extraits de Balzac dans les manuels scolaires / N. Denizot 59
S![]() e préparer à entrer en sixième sans le savoir… / A.-M. Jovenet 85
e préparer à entrer en sixième sans le savoir… / A.-M. Jovenet 85
D![]() e la troisième à la seconde : rompre ou ne pas rompre ? / C. Mercier 101
e la troisième à la seconde : rompre ou ne pas rompre ? / C. Mercier 101
É![]() crire à l’université : continuités ou ruptures ? / I. Delcambre 121
crire à l’université : continuités ou ruptures ? / I. Delcambre 121
![]() Sur les traces des élèves déscolarisés ou en risque de décrochage / M. Esterle Hedibel 137
Sur les traces des élèves déscolarisés ou en risque de décrochage / M. Esterle Hedibel 137
![]() Des RASED faisons table rase / P. Heems 151
Des RASED faisons table rase / P. Heems 151
![]() Quand des élèves de 6e se souviennent de leurs lectures de CM2 / M. Lusetti 155
Quand des élèves de 6e se souviennent de leurs lectures de CM2 / M. Lusetti 155
« ![]() On a travaillé sans s’en rendre compte ! » / S. Michieletto 183
On a travaillé sans s’en rendre compte ! » / S. Michieletto 183
![]() Des nouvelles du livre pour la jeunesse : Le vampire (3) / É. Vlieghe 189
Des nouvelles du livre pour la jeunesse : Le vampire (3) / É. Vlieghe 189
Éditorial
La vie d’un enfant est faite d’une succession de bouleversements, de ruptures : il y a le premier cri, le premier pas, le premier mot, il y a la première séparation d’avec le père ou la mère (la crèche, l’école). Commence alors la vie de l’élève qui est faite, elle aussi, d’une succession de bouleversements, de ruptures.
Il y a le premier jour, partagé entre les pleurs et l’émerveillement, il y a les premiers essais d’écriture, de lecture. Il y a le passage à la grande école où le grand de maternelle redevient le petit du CP. Il y a, peut-être, les premiers échecs, les premières orientations (CLIS, SEGPA…) Il y a le passage au collège où le grand de CM2 redevient le petit de sixième, ensuite, pour la plupart, au lycée (qu’il soit professionnel, technique ou général) puis, éventuellement, les études supérieures. Il y a la longue liste des examens qui ponctue ce parcours d’obstacles à chaque fois plus difficiles à franchir.
Bien entendu, ces moments de rupture que l’institution de l’École impose aux élèves en leur demandant à chaque fois d’être un peu plus autonomes ne correspondent jamais (ou alors par miracle) aux évolutions réelles dans le développement de l’enfant, à son parcours personnel. […]
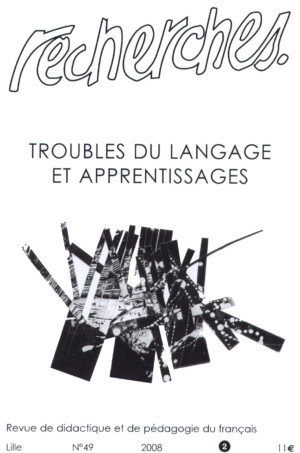 Le numéro s’intéresse plus particulièrement aux difficultés d’apprentissage en français liées à la dyslexie et à la dysphasie. L’accompagnement des difficultés engendrées par ces handicaps appelle une réponse qui ne peut pas être seulement pédagogique, mais qui doit être élaborée en partenariat avec d’autres champs professionnels comme le social, la santé ou l’éducatif, pour que soient conjuguées les aides apportées. C’est donc un numéro polyphonique que nous proposons, avec des approches pluricatégorielles du trouble. On y trouvera la voix d’un parent d’enfant porteur de dysphasie, celles de jeunes adultes dyslexiques, celles de professionnels de la santé. Feront écho à ces approches des analyses et des propositions pédagogiques.
Le numéro s’intéresse plus particulièrement aux difficultés d’apprentissage en français liées à la dyslexie et à la dysphasie. L’accompagnement des difficultés engendrées par ces handicaps appelle une réponse qui ne peut pas être seulement pédagogique, mais qui doit être élaborée en partenariat avec d’autres champs professionnels comme le social, la santé ou l’éducatif, pour que soient conjuguées les aides apportées. C’est donc un numéro polyphonique que nous proposons, avec des approches pluricatégorielles du trouble. On y trouvera la voix d’un parent d’enfant porteur de dysphasie, celles de jeunes adultes dyslexiques, celles de professionnels de la santé. Feront écho à ces approches des analyses et des propositions pédagogiques. Le numéro se penche sur une problématique récurrente. Sujet traditionnel de polémiques et d’injonctions institutionnelles idéologiquement marquées, cette problématique est aussi une préoccupation constante pour l’enseignant. Loin des discours simplificateurs, il s’agit d’abord d’interroger une norme qui ne va pas de soi. Cela conduit à prendre en compte le rapport des élèves à leur propre langue non pour la dénigrer mais pour aider les élèves à objectiver des pratiques linguistiques plurielles. Cette démarche réflexive sur la langue a aussi le souci de donner du sens à l’enseignement de la grammaire. Elle postule que développer la curiosité et la réflexion métalinguistiques est une condition indispensable pour la maitrise de la langue. Les analyses et les démarches s’intéressent aux divers aspects concernant l’enseignement et l’apprentissage des questions de langue, du primaire au lycée en passant par le collège. Un article présente une réflexion issue de lectures théoriques ; un article et une bibliographie fournissent également des pistes pour travailler avec les livres qui mettent la langue en jeu(x).
Le numéro se penche sur une problématique récurrente. Sujet traditionnel de polémiques et d’injonctions institutionnelles idéologiquement marquées, cette problématique est aussi une préoccupation constante pour l’enseignant. Loin des discours simplificateurs, il s’agit d’abord d’interroger une norme qui ne va pas de soi. Cela conduit à prendre en compte le rapport des élèves à leur propre langue non pour la dénigrer mais pour aider les élèves à objectiver des pratiques linguistiques plurielles. Cette démarche réflexive sur la langue a aussi le souci de donner du sens à l’enseignement de la grammaire. Elle postule que développer la curiosité et la réflexion métalinguistiques est une condition indispensable pour la maitrise de la langue. Les analyses et les démarches s’intéressent aux divers aspects concernant l’enseignement et l’apprentissage des questions de langue, du primaire au lycée en passant par le collège. Un article présente une réflexion issue de lectures théoriques ; un article et une bibliographie fournissent également des pistes pour travailler avec les livres qui mettent la langue en jeu(x).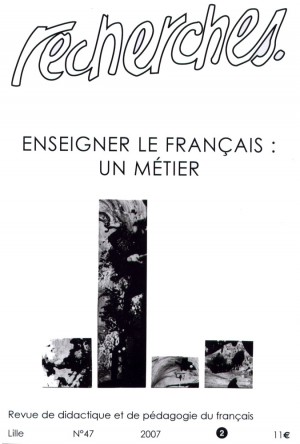 Enseigner est un métier, à n’en pas douter, mais enseigner le français ? La spécificité disciplinaire change-t-elle le métier ? C’est la question que veut poser ce numéro de Recherches en interrogeant la manière dont vivent leur métier les enseignants de français que sont les instituteurs ou institutrices, les professeur-es des écoles, les professeur-es de français du collège et des lycées. La particularité de ce numéro est d’approcher le métier en tant que tel, avec ce qu’il donne à vivre en termes d’activités didactiques, pédagogiques, administratives, institutionnelles, mais aussi en termes d’identité et de rapport au travail. Il s’agit de donner à voir comment le métier est vécu par certains de ceux qui le vivent sans dogmatisme et surtout sans nostalgie, mais au contraire avec la volonté de montrer des facettes diverses du métier quand il se vit au quotidien, par des réflexions générales, des analyses et par la présentation d’activités de « français » (qu’elles soient disciplinaires ou transdisciplinaires).
Enseigner est un métier, à n’en pas douter, mais enseigner le français ? La spécificité disciplinaire change-t-elle le métier ? C’est la question que veut poser ce numéro de Recherches en interrogeant la manière dont vivent leur métier les enseignants de français que sont les instituteurs ou institutrices, les professeur-es des écoles, les professeur-es de français du collège et des lycées. La particularité de ce numéro est d’approcher le métier en tant que tel, avec ce qu’il donne à vivre en termes d’activités didactiques, pédagogiques, administratives, institutionnelles, mais aussi en termes d’identité et de rapport au travail. Il s’agit de donner à voir comment le métier est vécu par certains de ceux qui le vivent sans dogmatisme et surtout sans nostalgie, mais au contraire avec la volonté de montrer des facettes diverses du métier quand il se vit au quotidien, par des réflexions générales, des analyses et par la présentation d’activités de « français » (qu’elles soient disciplinaires ou transdisciplinaires).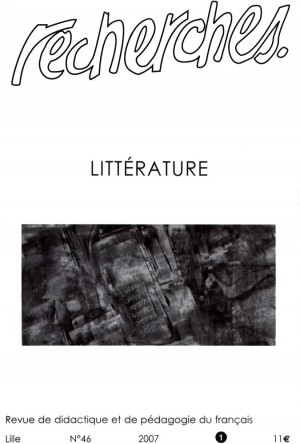 C’est loin des polémiques que le numéro envisage la littérature comme objet d’enseignement. Il s’agit dès lors d’interroger les enjeux et les modalités de la construction du sens. Quelle relation se construit entre l’élève et le livre et comment se construit-elle ? Quels dispositifs d’apprentissage mettre en place pour une pédagogie de la réception littéraire qui tienne compte de l’étrangeté de cet objet pour les élèves ? En quoi l’intertextualité peut-elle favoriser cette réception ? Quelle place pour l’écriture d’invention dans l’approche de l’œuvre littéraire ?
C’est loin des polémiques que le numéro envisage la littérature comme objet d’enseignement. Il s’agit dès lors d’interroger les enjeux et les modalités de la construction du sens. Quelle relation se construit entre l’élève et le livre et comment se construit-elle ? Quels dispositifs d’apprentissage mettre en place pour une pédagogie de la réception littéraire qui tienne compte de l’étrangeté de cet objet pour les élèves ? En quoi l’intertextualité peut-elle favoriser cette réception ? Quelle place pour l’écriture d’invention dans l’approche de l’œuvre littéraire ?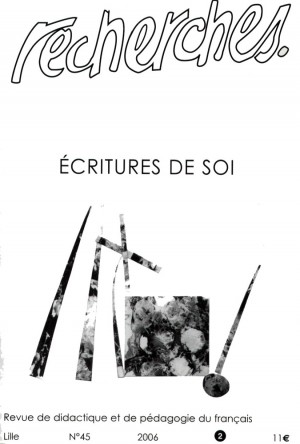 Le numéro s’intéresse à un objet, en apparence consensuel du primaire à l’université, mais qui recoupe des réalités multiples, disparates et parfois discutables. Loin d’être récente, l’écriture de soi semble s’être généralisée au gré des instructions officielles avec des finalités et des modalités différentes.
Le numéro s’intéresse à un objet, en apparence consensuel du primaire à l’université, mais qui recoupe des réalités multiples, disparates et parfois discutables. Loin d’être récente, l’écriture de soi semble s’être généralisée au gré des instructions officielles avec des finalités et des modalités différentes.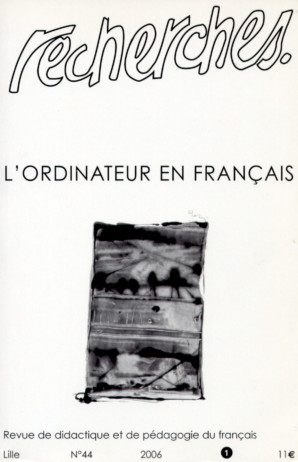 Le numéro pose la question de l’intérêt de l’outil informatique dans les pratiques professionnelles de l’enseignant de français. Enseigner avec l’ordinateur, c’est à la fois utiliser un outil supplémentaire et, dans un même temps, démystifier la place de cet outil dans les représentations des professeurs, des élèves et de l’institution. Il s’agit donc d’interroger les apports de l’ordinateur sur un plan didactique et pédagogique. Quelle place pour lui dans la classe ? En quoi l’ordinateur modifie-t-il le rapport de l’élève aux apprentissages ? L’ordinateur peut aussi modifier le lien de l’enseignant à sa pratique. Qu’apporte-il en matière d’écriture professionnelle ? En quoi influe-t-il sur l’identité professionnelle de l’enseignant ? L’entrée de l’ordinateur dans les classes pose enfin la question des nouveaux rapports qui peuvent s’instaurer entre l’école et les parents.
Le numéro pose la question de l’intérêt de l’outil informatique dans les pratiques professionnelles de l’enseignant de français. Enseigner avec l’ordinateur, c’est à la fois utiliser un outil supplémentaire et, dans un même temps, démystifier la place de cet outil dans les représentations des professeurs, des élèves et de l’institution. Il s’agit donc d’interroger les apports de l’ordinateur sur un plan didactique et pédagogique. Quelle place pour lui dans la classe ? En quoi l’ordinateur modifie-t-il le rapport de l’élève aux apprentissages ? L’ordinateur peut aussi modifier le lien de l’enseignant à sa pratique. Qu’apporte-il en matière d’écriture professionnelle ? En quoi influe-t-il sur l’identité professionnelle de l’enseignant ? L’entrée de l’ordinateur dans les classes pose enfin la question des nouveaux rapports qui peuvent s’instaurer entre l’école et les parents.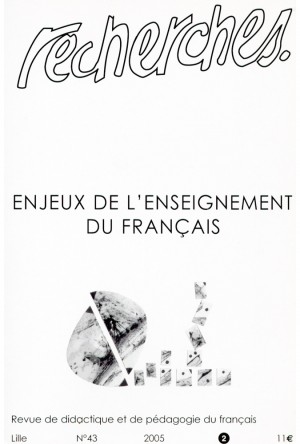 La question des enjeux du français n’est pas nouvelle à Recherches, elle est au cœur de nos préoccupations depuis la naissance de la revue et oriente notre réflexion et nos propositions. Le numéro revient de manière explicite sur les problèmes professionnels posés par l’enseignement du français. C’est la définition même de la discipline qui est ici interrogée. Elle pose bien sûr question à la didactique et à l’Institution. Elle fait aussi le lit de réactions conservatrices, qu’elles se retrouvent dans la presse ou, plus scandaleusement encore, dans des propositions parlementaires. Loin de la logique de ces discours réactionnaires, des enseignants témoignent de l’aspect composite, multiréférentiel de la discipline et/ou proposent des dispositifs qui mettent en jeu ses enjeux : au primaire, au collège, au lycée, à l’IUFM, mais aussi en prison.
La question des enjeux du français n’est pas nouvelle à Recherches, elle est au cœur de nos préoccupations depuis la naissance de la revue et oriente notre réflexion et nos propositions. Le numéro revient de manière explicite sur les problèmes professionnels posés par l’enseignement du français. C’est la définition même de la discipline qui est ici interrogée. Elle pose bien sûr question à la didactique et à l’Institution. Elle fait aussi le lit de réactions conservatrices, qu’elles se retrouvent dans la presse ou, plus scandaleusement encore, dans des propositions parlementaires. Loin de la logique de ces discours réactionnaires, des enseignants témoignent de l’aspect composite, multiréférentiel de la discipline et/ou proposent des dispositifs qui mettent en jeu ses enjeux : au primaire, au collège, au lycée, à l’IUFM, mais aussi en prison. Les opérations de classement font partie des pratiques quotidiennes spontanées de l’enseignement du français. Il s’agit ici d’interroger ces classements proposés aux élèves comme objets de savoir et leurs dérives normatives. La notion de typologies de textes est-elle dépassée ? Quel statut scolaire accorder aux catégories grammaticales ? Quelles représentations ces habitudes de classements induisent-elles chez les élèves ?
Les opérations de classement font partie des pratiques quotidiennes spontanées de l’enseignement du français. Il s’agit ici d’interroger ces classements proposés aux élèves comme objets de savoir et leurs dérives normatives. La notion de typologies de textes est-elle dépassée ? Quel statut scolaire accorder aux catégories grammaticales ? Quelles représentations ces habitudes de classements induisent-elles chez les élèves ?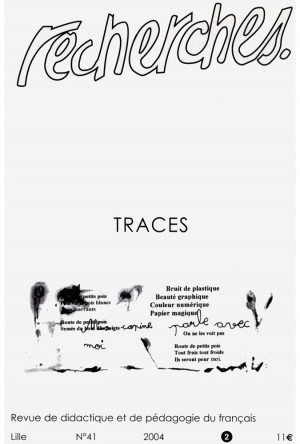 Entre les traces écrites de l’enseignant et celles conservées et/ou produites par les élèves, quelles traces cognitives des apprentissages effectués ? Le numéro pose la question du statut de la trace de l’élève dans l’univers scolaire. Quelle place pour les traces écrites des élèves ? En quoi ces écrits portent-ils des traces de capacités cognitives ? Des propositions pour accorder à ces traces une véritable fonction dans les apprentissages en primaire, en UPI, au collège, au lycée, ainsi que dans le dialogue professeur-élève. Il s’agit aussi d’interroger le rituel de la trace écrite dans le cahier de l’élève, dans le manuel et au tableau. Enfin, le numéro s’intéresse aux traces des apprentissages dans les évaluations au collège et au lycée.
Entre les traces écrites de l’enseignant et celles conservées et/ou produites par les élèves, quelles traces cognitives des apprentissages effectués ? Le numéro pose la question du statut de la trace de l’élève dans l’univers scolaire. Quelle place pour les traces écrites des élèves ? En quoi ces écrits portent-ils des traces de capacités cognitives ? Des propositions pour accorder à ces traces une véritable fonction dans les apprentissages en primaire, en UPI, au collège, au lycée, ainsi que dans le dialogue professeur-élève. Il s’agit aussi d’interroger le rituel de la trace écrite dans le cahier de l’élève, dans le manuel et au tableau. Enfin, le numéro s’intéresse aux traces des apprentissages dans les évaluations au collège et au lycée.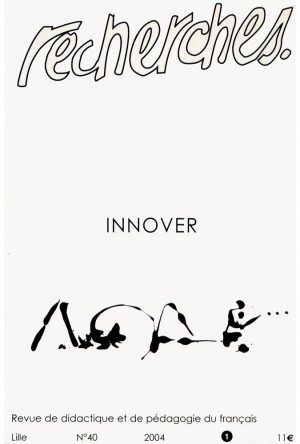 Née dans un contexte de rénovation (rénovation des collèges entre autres), la revue, qui fête ses 20 ans et n’est donc plus – pour une revue – toute neuve, se demande aujourd’hui, selon un paradoxe dont elle est coutumière, ce que peut vouloir dire la nouveauté. Lorsque l’institution veut intégrer, voire imposer l’innovation au cœur des programmes (cf. l’écriture d’invention introduite dans les programmes au lycée en 2000 et dont on peut interroger la réelle nouveauté) et non plus seulement encourager les démarches locales et militantes, innover n’a plus les mêmes sens que dans les années 80. C’est cette polysémie actuelle du mot innovation que déclinent les propositions et les interrogations individuelles et collectives de ce numéro : faire contre, faire à contre-pied ; mais aussi maintenant faire avec, faire du neuf avec du neuf – avec les injonctions paradoxales des programmes, avec les nouvelles technologies, etc. – faire du neuf avec du vieux – recycler en bricolant ce qui a déjà été fait mais pas comme ça, pas ici, pas maintenant – saisir toutes les opportunités, à l’école primaire, en UPI ou encore en formation initiale des enseignants, d’inventer pour les élèves des raisons d’être à l’école et pour l’enseignant de continuer chaque jour à enseigner.
Née dans un contexte de rénovation (rénovation des collèges entre autres), la revue, qui fête ses 20 ans et n’est donc plus – pour une revue – toute neuve, se demande aujourd’hui, selon un paradoxe dont elle est coutumière, ce que peut vouloir dire la nouveauté. Lorsque l’institution veut intégrer, voire imposer l’innovation au cœur des programmes (cf. l’écriture d’invention introduite dans les programmes au lycée en 2000 et dont on peut interroger la réelle nouveauté) et non plus seulement encourager les démarches locales et militantes, innover n’a plus les mêmes sens que dans les années 80. C’est cette polysémie actuelle du mot innovation que déclinent les propositions et les interrogations individuelles et collectives de ce numéro : faire contre, faire à contre-pied ; mais aussi maintenant faire avec, faire du neuf avec du neuf – avec les injonctions paradoxales des programmes, avec les nouvelles technologies, etc. – faire du neuf avec du vieux – recycler en bricolant ce qui a déjà été fait mais pas comme ça, pas ici, pas maintenant – saisir toutes les opportunités, à l’école primaire, en UPI ou encore en formation initiale des enseignants, d’inventer pour les élèves des raisons d’être à l’école et pour l’enseignant de continuer chaque jour à enseigner.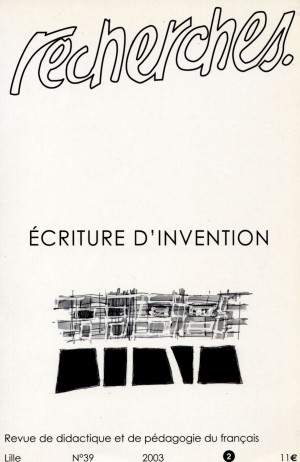 « L’écriture d’invention » fait son apparition dans les nouveaux programmes du lycée et devient sujet de baccalauréat. Avec ce numéro, consacré à l’écriture d’invention, Recherches poursuit son cycle d’exploration de ces injonctions institutionnelles qui font écho, de manière plus ou moins lointaine, à des principes qu’elle a elle-même défendus et interroge les discours des instructions officielles comme ceux de leurs promoteurs et de leurs adversaires, en tentant de voir ce qu’elle recoupe comme pratiques effectives, du lycée à la maternelle. Sont aussi proposées des démarches et des réflexions où l’écriture d’invention puisse remplir les objectifs que lui assignaient les intentions des programmes ou encore ceux que l’on peut assigner à l’écriture – organiser sa pensée, construire ses savoirs, prendre du recul, des risques – dans les lieux divers où l’on écrit, à l’école bien sûr mais aussi en prison ou dans les ateliers d’écriture.
« L’écriture d’invention » fait son apparition dans les nouveaux programmes du lycée et devient sujet de baccalauréat. Avec ce numéro, consacré à l’écriture d’invention, Recherches poursuit son cycle d’exploration de ces injonctions institutionnelles qui font écho, de manière plus ou moins lointaine, à des principes qu’elle a elle-même défendus et interroge les discours des instructions officielles comme ceux de leurs promoteurs et de leurs adversaires, en tentant de voir ce qu’elle recoupe comme pratiques effectives, du lycée à la maternelle. Sont aussi proposées des démarches et des réflexions où l’écriture d’invention puisse remplir les objectifs que lui assignaient les intentions des programmes ou encore ceux que l’on peut assigner à l’écriture – organiser sa pensée, construire ses savoirs, prendre du recul, des risques – dans les lieux divers où l’on écrit, à l’école bien sûr mais aussi en prison ou dans les ateliers d’écriture.