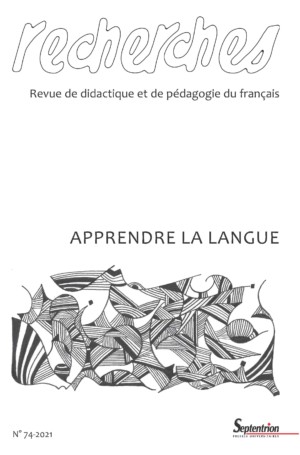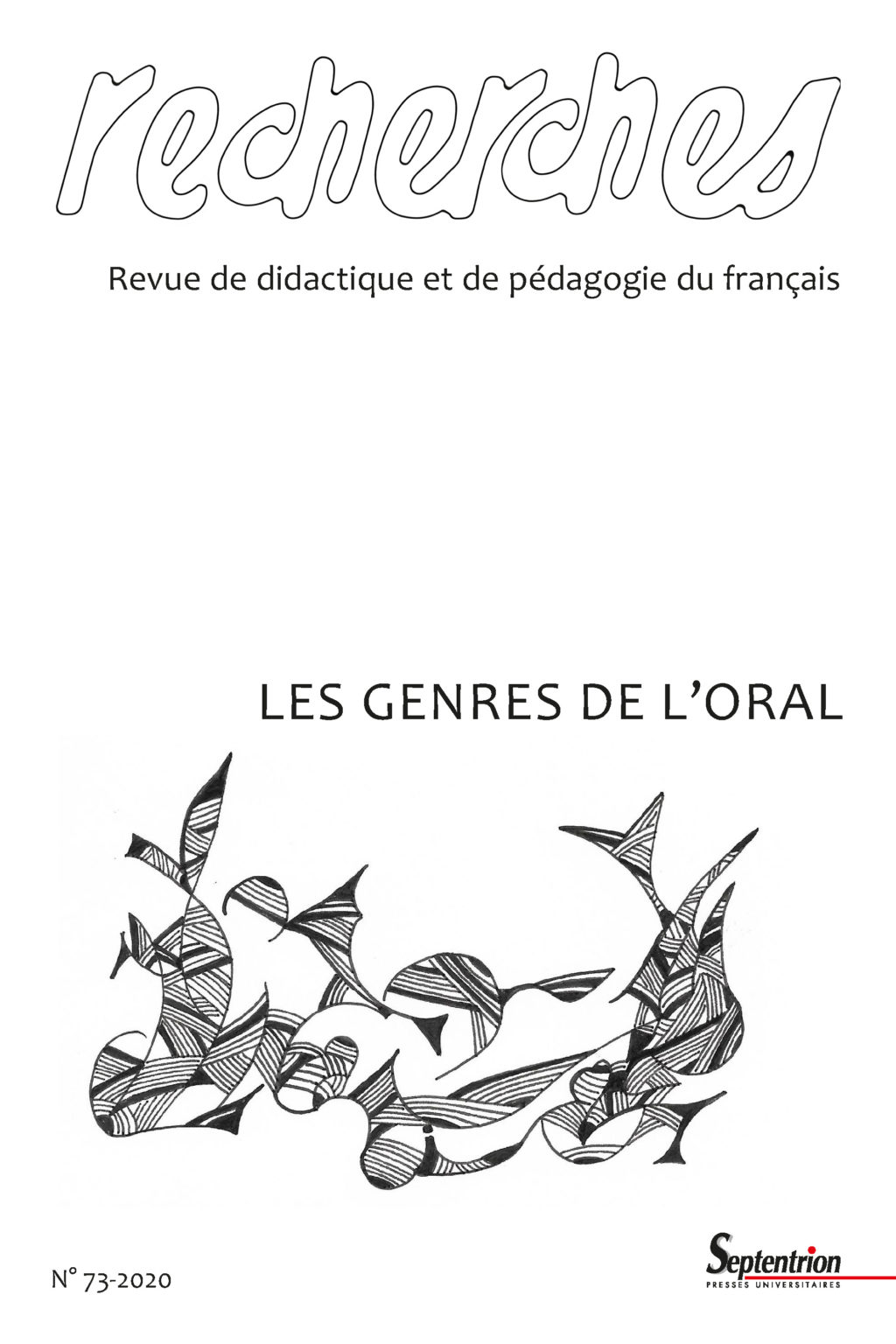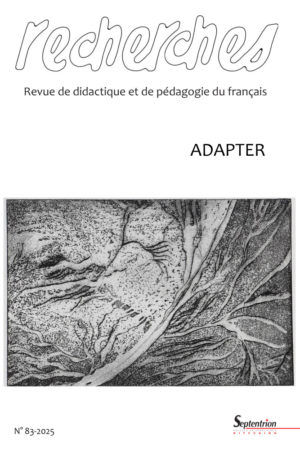
Le numéro se penche sur les adaptations multiformes et incontournables en cours de français. Comment adapter supports, ressources et dispositifs aux apprentissages en jeu, tout en s’adaptant à la diversité des publics et aux injonctions institutionnelles ? Le numéro présente et analyse des démarches (de la maternelle à l’enseignement supérieur en passant par l’enseignement spécialisé) qui concilient ces impératifs à l’heure de la pédagogie universelle.
.
Le numéro est disponible aux Presses universitaires du Septentrion.
Sommaire
L’ULIS, quelle odyssée !
Stéphanie Michieletto-Vanlancker
Répondre aux besoins de chacun : fondements et mise en œuvre du plan de travail
Maéva Béhague
Comment la pédagogie universelle éclaire la pratique du plan de travail
Claire Goulet, Hélène Le Levier, Maéva Béhague
Comment adapter des consignes multiples en séance de français
Fabienne Bureau
Adapter les consignes scolaires pour les élèves sourds et les élèves autistes Asperger, du primaire au supérieur : tenter des solutions communes pour des publics différents
Leïla Boutora
Du texte à la grammaire et retour : de quelques adaptations didactiques
Ecaterina Bulea Bronckart
Adaptations d’œuvres littéraires en BD : quelles lectures en classe ?
Hélène Raux
Que la parole soit ! Et la parole fut. Ou comment adapter un roman et le mettre en voix
Corinne Souche
Repenser le coin lecture comme un espace d’apprentissage
Lucile Berthod
Lire Moby Dick au prisme de dispositifs didactiques éditoriaux et institutionnels
Virginie Actis
S’adapter à une commande institutionnelle : les enseignant·es face à la spécialité Humanités, Littérature et Philosophie au lycée
Maïté Eugène, Bettina Berton
Éditorial
On pourrait à priori s’étonner que Recherches consacre un numéro spécifique à ce qui constitue, de fait, le cœur de l’ensemble de ses numéros, à savoir l’analyse des situations professionnelles des enseignant·e·s et la réflexion sur les moyens permettant d’accompagner au mieux tous les élèves, quels qu’ils soient, et donc d’adapter ou de s’adapter. Mais ce serait oublier le contexte de parution de ce numéro, celui de l’école inclusive du XXIe siècle. En effet, ce contexte nous invite à nous interroger sur les ressorts de l’adaptation, aussi bien pour les élèves dont la grande hétérogénéité nous conduit à adapter nos supports et nos manières de faire, que pour les enseignant·e·s sur lesquel·le·s pèsent des attentes et des contraintes toujours plus fortes, en perpétuelles adaptations.
Si, autrefois, l’adaptation était perçue comme une mesure compensatoire exceptionnelle réservée à une poignée d’élèves en difficultés d’apprentissage, elle semble s’imposer aujourd’hui comme une dimension centrale de tout enseignement, de la maternelle jusqu’au supérieur, et il y a fort à parier que le public des apprenant·e·s en situation de handicap (auquel la revue avait déjà consacré son numéro 49 : Troubles du langage et apprentissages) y soit pour quelque chose, ce dont on ne peut que se réjouir, bien entendu.
L’école du XXIe siècle affiche donc la volonté d’accueillir et faire réussir tous ses élèves, les inclure dans toute l’étendue de leurs différences, de leur diversité et donc de leurs besoins : diversité des profils cognitifs, des parcours migratoires (étudiant·e·s en exil, élèves allophones…), des rythmes d’apprentissage ou encore des spécialités (sportifs et sportives de haut niveau, musicien·ne·s…), diversité des milieux socioculturels, besoins spécifiques liés à une situation de handicap, besoins particuliers liés aux troubles d’apprentissage… Cette hétérogénéité des apprenant·e·s questionne nos pratiques pédagogiques et didactiques et remet en cause, à juste titre, des modèles pédagogiques traditionnels sinon fantasmés car construits sur l’idée d’un élève « moyen » qui n’a jamais existé que de manière abstraite dans les programmes ou les manuels scolaires.
Mais pourquoi « adapter » (et non « inclure ») quand on sait, par exemple, que cette notion a disparu des réalités du primaire et du secondaire depuis que les fameuses classes d’adaptation, les classes d’intégration et autres dispositifs mis en place autrefois pour accompagner des publics dits spécifiques n’existent plus ? Ce choix de la rédaction, qui n’est pas innocent il va sans dire, met en exergue une posture, celle de l’enseignant·e qui doit constamment faire avec la diversité du public qu’il accueille, qui s’adapte à ses élèves et qui doit s’adapter en même temps aux injonctions variables de l’institution qu’il sert, qui adapte ses cours et qui adapte ses supports… bref, un·e enseignant·e qui bricole pour reprendre à Philippe Perrenoud cette métaphore dont la revue se sert si souvent au fil de ses numéros (dont le numéro 66 : Bricoler, inventer, recycler).
C’est qu’adapter ou s’adapter implique une certaine plasticité dont l’étymologie (ad aptare, ajuster à…) nous rappelle d’ailleurs qu’elle est toute tournée vers l’autre. C’est aussi parce qu’adapter, c’est nuancer ce mythe selon lequel l’école inclurait naturellement tous les profils d’élèves. L’acte d’« inclure » (pour l’enseignant qui s’y essaie comme pour l’élève qui en est l’objet) n’est-il pas parfois rigide sinon brutal, voire culpabilisant ? Adapter, c’est toujours faire des choix, c’est ajuster, c’est trouver le juste niveau. C’est proposer des aménagements qui ouvrent réellement des possibles plutôt qu’ils ne les referment ; c’est aussi questionner la norme et ce que l’on croit être « normal » dans les apprentissages (sur la base de quels critères et avec quelles conséquences pour celles et ceux qui s’en écarteraient ?).
Mais qui de l’école ou du public doit s’adapter à l’autre ? Et comment adapter sans stigmatiser ni même maltraiter ? C’est de ces questions que traite le présent numéro dont les articles mettent en exergue toute la complexité de cette posture et montrent que l’adaptation n’est jamais un mouvement univoque. Bien au contraire, elle est un ensemble de pratiques et de réflexions en constante évolution et qui requiert l’engagement de l’ensemble des acteurs d’un établissement, et à fortiori du monde éducatif. En effet, comment inclure quand des classes sont surchargées, quand le matériel à disposition s’avère inadapté, quand nombre d’évaluations sont encore standardisées ou quand la formation fait défaut ? Les contributions à ce numéro explorent donc l’acte d’adapter sous toutes ses facettes (didactique, pédagogique, institutionnelle… mais aussi éthique et politique dans une moindre mesure) tout en s’inscrivant dans la réflexion actuelle sur l’école inclusive et la pédagogie universelle.
En outre, cette pédagogie inclusive, l’institution l’assène avec toujours plus de force, enjoignant ses enseignant·e·s à la mettre en œuvre sans nécessairement leur donner tous les moyens d’y parvenir. On ne saurait ignorer le rôle capital de la formation des enseignant·e·s à ce sujet, qu’elle soit initiale ou continue, une formation qui s’amenuise constamment et qui, réduite à peau de chagrin, se limite souvent à des visioconférences calées le soir, à suivre de chez soi, en dehors du temps scolaire. En effet, comment accompagner les enseignant·e·s d’aujourd’hui à envisager toute la variété des publics (par exemple celui des apprenant·e·s avec troubles du neurodéveloppement) pour leur permettre de s’y adapter au mieux ? Et comment préparer celles et ceux de demain à cette composante essentielle de notre métier ? Inclure ne se décrète pas simplement, c’est une posture professionnelle qui exige de l’enseignant·e réflexivité et analyse fine des besoins de ses élèves pour pouvoir mobiliser un large éventail de stratégies et de dispositifs pédagogiques sur mesure.
Un autre écueil enfin – et qui est intimement lié au précédent puisque l’acte d’adapter ne saurait faire l’économie d’une formation digne de ce nom – concerne les outils numériques qui occupent une place toujours plus importante dans les réflexions actuelles sur l’adaptation et dont l’institution se fait le porte-voix. Qu’il s’agisse de logiciels de compensation ou encore d’outils d’accessibilité, ces outils, nombreux, ouvrent indéniablement de nouvelles et prometteuses perspectives. Mais ils invitent à la prudence et ne sauraient être envisagés comme des solutions miracles car leur efficacité est tributaire de la manière dont ils sont utilisés et dont ils peuvent s’inscrire dans le dispositif pédagogique construit par l’enseignant·e.
Les adaptations, au sens où nous l’entendons ici, ne peuvent pas se réduire à une simple liste de mesures compensatoires, d’aménagements techniques ou encore de dispositifs pédagogiques figés. Elles constituent un véritable paradigme éducatif qui place chaque élève au cœur même de l’acte d’apprendre, qu’il s’agisse de différenciation pédagogique (le plan de travail par exemple), d’aménagements raisonnables et raisonnés pour les élèves en situation de handicap, de dispositifs pédagogiques particuliers ou encore de modalités d’évaluation alternatives…
L’adaptation n’est pas une concession faite à quelques-un·e·s, elle est la condition d’une école véritablement inclusive. Toutes les pratiques et les adaptations proposées dans le présent numéro témoignent donc d’une même volonté : faire de la classe un espace où chacun·e peut apprendre et progresser à son rythme.
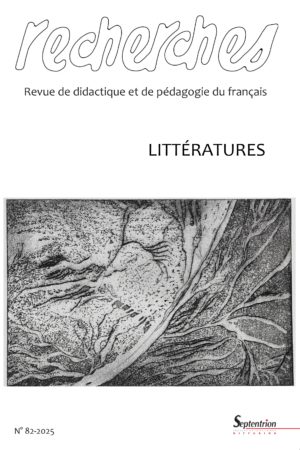
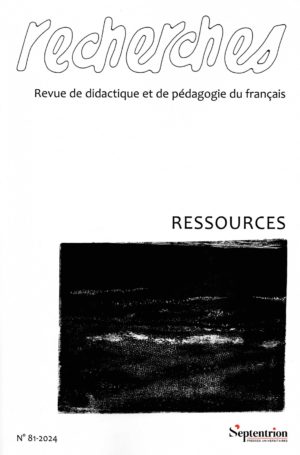

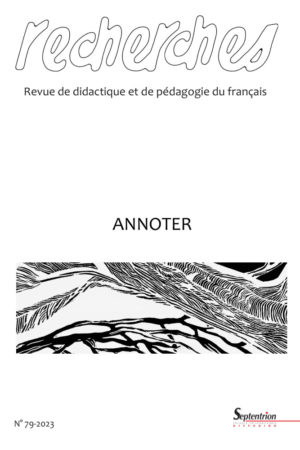

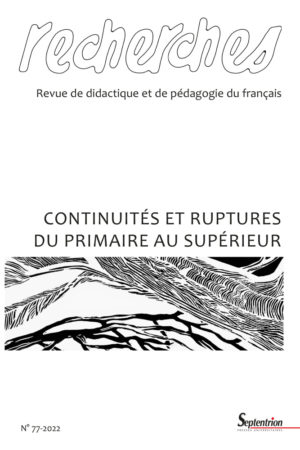
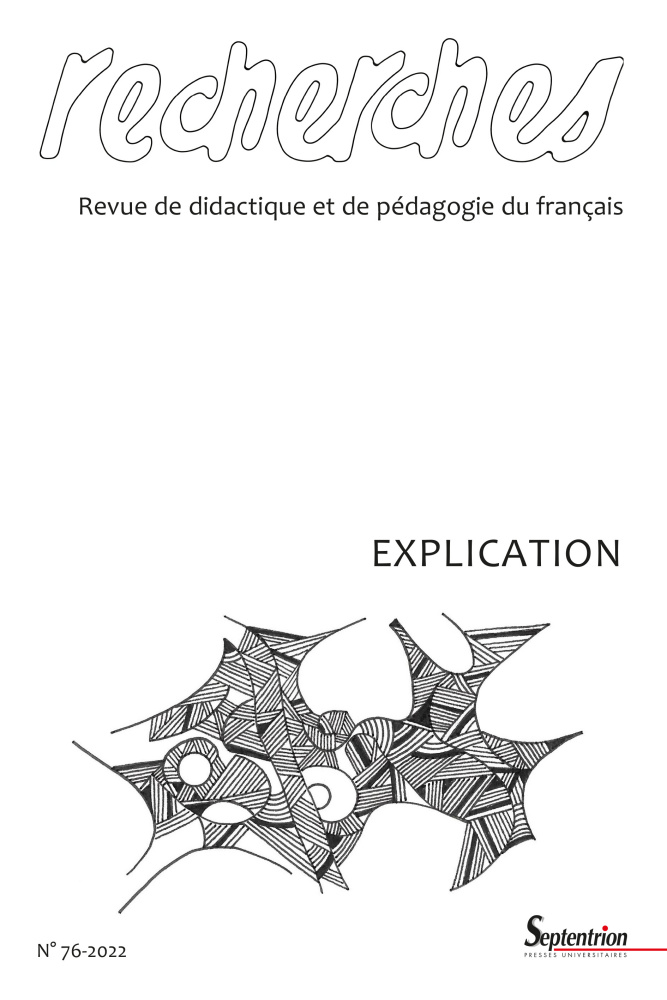
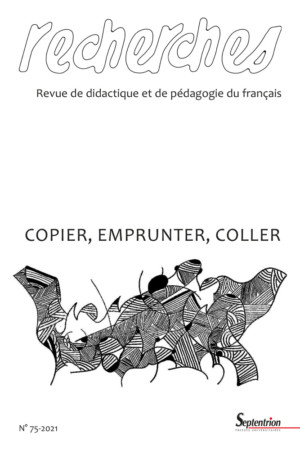
 Le numérique s’est imposé à l’école comme à la société dans son ensemble. Sont entrés dans les classes nombre d’objets concrets ou virtuels dont l’utilisation ne va pas de soi, pour des raisons techniques, didactiques et pédagogiques. Enseigner avec le numérique conduit à se débarrasser de quelques idées reçues (telles que la familiarité des élèves avec ces objets, le caractère novateur du numérique ou ses effets supposés dans la lutte contre l’échec scolaire et les inégalités). Les analyses et les démarches d’enseignement présentées dans ce numéro éclairent les enjeux et conditions d’usages pertinents du numérique au service des apprentissages du cours de français.
Le numérique s’est imposé à l’école comme à la société dans son ensemble. Sont entrés dans les classes nombre d’objets concrets ou virtuels dont l’utilisation ne va pas de soi, pour des raisons techniques, didactiques et pédagogiques. Enseigner avec le numérique conduit à se débarrasser de quelques idées reçues (telles que la familiarité des élèves avec ces objets, le caractère novateur du numérique ou ses effets supposés dans la lutte contre l’échec scolaire et les inégalités). Les analyses et les démarches d’enseignement présentées dans ce numéro éclairent les enjeux et conditions d’usages pertinents du numérique au service des apprentissages du cours de français.