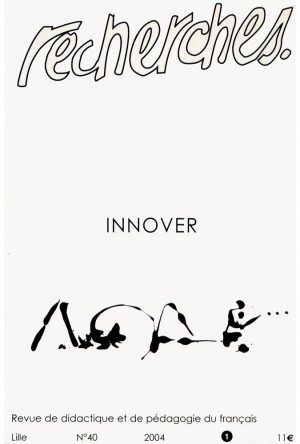 Née dans un contexte de rénovation (rénovation des collèges entre autres), la revue, qui fête ses 20 ans et n’est donc plus – pour une revue – toute neuve, se demande aujourd’hui, selon un paradoxe dont elle est coutumière, ce que peut vouloir dire la nouveauté. Lorsque l’institution veut intégrer, voire imposer l’innovation au cœur des programmes (cf. l’écriture d’invention introduite dans les programmes au lycée en 2000 et dont on peut interroger la réelle nouveauté) et non plus seulement encourager les démarches locales et militantes, innover n’a plus les mêmes sens que dans les années 80. C’est cette polysémie actuelle du mot innovation que déclinent les propositions et les interrogations individuelles et collectives de ce numéro : faire contre, faire à contre-pied ; mais aussi maintenant faire avec, faire du neuf avec du neuf – avec les injonctions paradoxales des programmes, avec les nouvelles technologies, etc. – faire du neuf avec du vieux – recycler en bricolant ce qui a déjà été fait mais pas comme ça, pas ici, pas maintenant – saisir toutes les opportunités, à l’école primaire, en UPI ou encore en formation initiale des enseignants, d’inventer pour les élèves des raisons d’être à l’école et pour l’enseignant de continuer chaque jour à enseigner.
Née dans un contexte de rénovation (rénovation des collèges entre autres), la revue, qui fête ses 20 ans et n’est donc plus – pour une revue – toute neuve, se demande aujourd’hui, selon un paradoxe dont elle est coutumière, ce que peut vouloir dire la nouveauté. Lorsque l’institution veut intégrer, voire imposer l’innovation au cœur des programmes (cf. l’écriture d’invention introduite dans les programmes au lycée en 2000 et dont on peut interroger la réelle nouveauté) et non plus seulement encourager les démarches locales et militantes, innover n’a plus les mêmes sens que dans les années 80. C’est cette polysémie actuelle du mot innovation que déclinent les propositions et les interrogations individuelles et collectives de ce numéro : faire contre, faire à contre-pied ; mais aussi maintenant faire avec, faire du neuf avec du neuf – avec les injonctions paradoxales des programmes, avec les nouvelles technologies, etc. – faire du neuf avec du vieux – recycler en bricolant ce qui a déjà été fait mais pas comme ça, pas ici, pas maintenant – saisir toutes les opportunités, à l’école primaire, en UPI ou encore en formation initiale des enseignants, d’inventer pour les élèves des raisons d’être à l’école et pour l’enseignant de continuer chaque jour à enseigner.
Le numéro est en vente sur notre site. Les articles sont téléchargeables sur cette page.
Sommaire
![]() L’innovation, épopée ou histoire ? / A. Barthélémy 9
L’innovation, épopée ou histoire ? / A. Barthélémy 9
![]() L’écriture d’invention, une pratique innovante ? / J.-A. Huynh 19
L’écriture d’invention, une pratique innovante ? / J.-A. Huynh 19
![]() Critiques interposées / C. Coget, A. Vignoble 53
Critiques interposées / C. Coget, A. Vignoble 53
![]() Je n’innove pas, je n’invente pas, je recycle : l’orthographe quand même… / M. Constant 71
Je n’innove pas, je n’invente pas, je recycle : l’orthographe quand même… / M. Constant 71
![]() « Qui est in ? Qui est out ? » / M. Habi 105
« Qui est in ? Qui est out ? » / M. Habi 105
![]() Insécurités masquées / C. Larat 113
Insécurités masquées / C. Larat 113
![]() Comment impliquer les parents dans la scolarité de leur enfant ? Quelques actions / M.-P. Delacourt, N. Dusart, A. Scy, J. Wachowski 125
Comment impliquer les parents dans la scolarité de leur enfant ? Quelques actions / M.-P. Delacourt, N. Dusart, A. Scy, J. Wachowski 125
![]() À l’affut. Innovation, opportunité / B. Liénard 133
À l’affut. Innovation, opportunité / B. Liénard 133
![]() Ces vieilles choses neuves de tous les jours / P. Heems 141
Ces vieilles choses neuves de tous les jours / P. Heems 141
![]() La créativité didactique et pédagogique, huit professeurs « inventent », dix articles pour poser les pistes de travail d’une recherche-innovation en cours / M. Bleuse, C. Charlet, A. Decottignies, D. Fabé, C. Féliers, D. Gyre, V. Louchart, S. Suffys 149
La créativité didactique et pédagogique, huit professeurs « inventent », dix articles pour poser les pistes de travail d’une recherche-innovation en cours / M. Bleuse, C. Charlet, A. Decottignies, D. Fabé, C. Féliers, D. Gyre, V. Louchart, S. Suffys 149
![]() Un groupe de recherche sur la créativité, l’inventivité professionnelle / S. Suffys 153
Un groupe de recherche sur la créativité, l’inventivité professionnelle / S. Suffys 153
![]() Pourquoi j’invente… / D. Fabé 157
Pourquoi j’invente… / D. Fabé 157
![]() Comment j’invente… / A. Decottignies 163
Comment j’invente… / A. Decottignies 163
![]() Quid novi sub sole ? Nescio / C. Féliers 171
Quid novi sub sole ? Nescio / C. Féliers 171
![]() Petite méthode pour devenir un professeur créatif (à l’usage des débutants) / D. Gyre 187
Petite méthode pour devenir un professeur créatif (à l’usage des débutants) / D. Gyre 187
![]() « Le plaisir du traitement de texte » ou comment leur dire : « Et si on écrivait… » / C. Charlet 193
« Le plaisir du traitement de texte » ou comment leur dire : « Et si on écrivait… » / C. Charlet 193
![]() Créativité et proximité avec la culture des élèves / M. Bleuse 201
Créativité et proximité avec la culture des élèves / M. Bleuse 201
![]() Aux « bases », nous opposerons les liens et la nécessité de savoir faire des liens… / S. Suffys 207
Aux « bases », nous opposerons les liens et la nécessité de savoir faire des liens… / S. Suffys 207
![]() S’inventer des conditions de travail / D. Gyre 219
S’inventer des conditions de travail / D. Gyre 219
![]() Un aperçu informel sur l’innovation et sur l’invention de pratiques singulières / C. Féliers 243
Un aperçu informel sur l’innovation et sur l’invention de pratiques singulières / C. Féliers 243
![]() Des nouvelles du livre pour la jeunesse : correspondances (2) / É. Vlieghe 249
Des nouvelles du livre pour la jeunesse : correspondances (2) / É. Vlieghe 249
Éditorial
1984-2004 : Recherches a vingt ans cette année ! Un numéro sur l’innovation est-ce bien raisonnable quand on a derrière soi de si longues années ? Pour une revue, l’âge, sans doute, est à doubler ou à tripler par rapport aux années d’une vie d’homme. Et nous avons probablement affaire à une Mémé-revue, du moins une revue adulte et mature… Si la naissance et les premières années de la revue s’inscrivent au cœur de la rénovation – rénovation des collèges, entre autres – ce numéro, précisément, est né d’un colloque interne où les membres de la rédaction ont pris position et finalement décidé que la revue poursuivrait sa vie de recherches, aidés en cela par tous ceux qui, lecteurs ou responsables institutionnels, ont refusé qu’elle disparaisse, en s’abonnant et en se réabonnant, ou en finançant des subventions. Qu’ils trouvent ici, dans ce numéro, une forme pédagogique et didactique de remerciement. […]
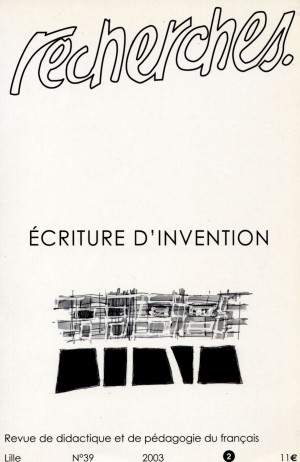 « L’écriture d’invention » fait son apparition dans les nouveaux programmes du lycée et devient sujet de baccalauréat. Avec ce numéro, consacré à l’écriture d’invention, Recherches poursuit son cycle d’exploration de ces injonctions institutionnelles qui font écho, de manière plus ou moins lointaine, à des principes qu’elle a elle-même défendus et interroge les discours des instructions officielles comme ceux de leurs promoteurs et de leurs adversaires, en tentant de voir ce qu’elle recoupe comme pratiques effectives, du lycée à la maternelle. Sont aussi proposées des démarches et des réflexions où l’écriture d’invention puisse remplir les objectifs que lui assignaient les intentions des programmes ou encore ceux que l’on peut assigner à l’écriture – organiser sa pensée, construire ses savoirs, prendre du recul, des risques – dans les lieux divers où l’on écrit, à l’école bien sûr mais aussi en prison ou dans les ateliers d’écriture.
« L’écriture d’invention » fait son apparition dans les nouveaux programmes du lycée et devient sujet de baccalauréat. Avec ce numéro, consacré à l’écriture d’invention, Recherches poursuit son cycle d’exploration de ces injonctions institutionnelles qui font écho, de manière plus ou moins lointaine, à des principes qu’elle a elle-même défendus et interroge les discours des instructions officielles comme ceux de leurs promoteurs et de leurs adversaires, en tentant de voir ce qu’elle recoupe comme pratiques effectives, du lycée à la maternelle. Sont aussi proposées des démarches et des réflexions où l’écriture d’invention puisse remplir les objectifs que lui assignaient les intentions des programmes ou encore ceux que l’on peut assigner à l’écriture – organiser sa pensée, construire ses savoirs, prendre du recul, des risques – dans les lieux divers où l’on écrit, à l’école bien sûr mais aussi en prison ou dans les ateliers d’écriture. Des évaluations nationales en CE2, en 6e, en 5e, en 2nde qui viennent s’ajouter aux examens : d’où vient cette systématisation de l’évaluation au niveau institutionnel et avec quels effets dans les classes ? Des articles qui tentent de cerner certaines impasses des formes institutionnelles d’évaluation du côté des enseignants – quand les cahiers d’évaluations ne sont pas exploitables, quand les résultats des évaluations nationales stigmatisent toujours les mêmes classes, des mêmes établissements – mais aussi du côté des élèves – de l’opacité, voire de la violence que représentent pour les élèves les évaluations nationales, les examens, voire l’évaluation en général. Qu’en faire ? des propositions de rémédiation à partir des évaluations nationales mais aussi l’élaboration d’autres évaluations adaptées à un public donné et ciblé – des enfants à risques de difficultés scolaires en maternelle, un élève primo-arrivant, etc. Quelques réflexions et propositions didactiques pour préparer les examens en français (brevet et baccalauréat), frontalement ou de biais.
Des évaluations nationales en CE2, en 6e, en 5e, en 2nde qui viennent s’ajouter aux examens : d’où vient cette systématisation de l’évaluation au niveau institutionnel et avec quels effets dans les classes ? Des articles qui tentent de cerner certaines impasses des formes institutionnelles d’évaluation du côté des enseignants – quand les cahiers d’évaluations ne sont pas exploitables, quand les résultats des évaluations nationales stigmatisent toujours les mêmes classes, des mêmes établissements – mais aussi du côté des élèves – de l’opacité, voire de la violence que représentent pour les élèves les évaluations nationales, les examens, voire l’évaluation en général. Qu’en faire ? des propositions de rémédiation à partir des évaluations nationales mais aussi l’élaboration d’autres évaluations adaptées à un public donné et ciblé – des enfants à risques de difficultés scolaires en maternelle, un élève primo-arrivant, etc. Quelques réflexions et propositions didactiques pour préparer les examens en français (brevet et baccalauréat), frontalement ou de biais.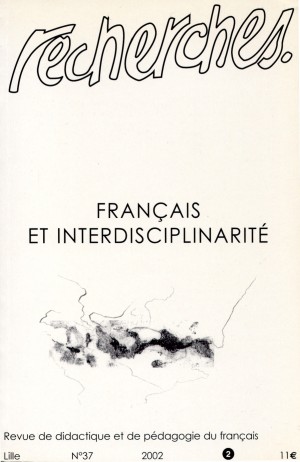
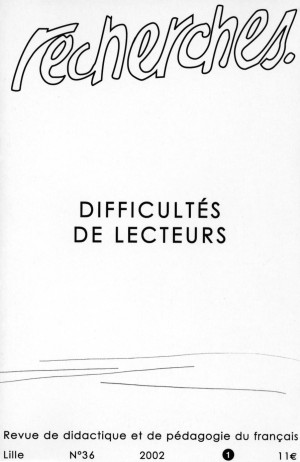 Quelles réalités se cachent derrière le trop fameux « ils ne savent pas lire » ? À la différence du n° 17, ce numéro est davantage centré sur l’apprenant et il est serti de multiples portraits de non-lecteurs mais aussi de lecteurs, pour essayer de mieux cerner la diversité des modes d’appropriation de l’écrit et des conditions qui rendent cette appropriation possible, parmi lesquelles la peur d’apprendre et le rôle de la médiation culturelle. Diversité également des publics évoqués puisque les difficultés ou les horizons de lecture présentés sont, entre autres, celles d’élèves d’école primaire, de 6e en REP, de BTS en chaudronnerie, d’un étudiant en faculté de lettres ou de détenus de la prison de Loos. Des activités qui cherchent, modestement mais résolument, à inventer pour s’adapter à ces diversités.
Quelles réalités se cachent derrière le trop fameux « ils ne savent pas lire » ? À la différence du n° 17, ce numéro est davantage centré sur l’apprenant et il est serti de multiples portraits de non-lecteurs mais aussi de lecteurs, pour essayer de mieux cerner la diversité des modes d’appropriation de l’écrit et des conditions qui rendent cette appropriation possible, parmi lesquelles la peur d’apprendre et le rôle de la médiation culturelle. Diversité également des publics évoqués puisque les difficultés ou les horizons de lecture présentés sont, entre autres, celles d’élèves d’école primaire, de 6e en REP, de BTS en chaudronnerie, d’un étudiant en faculté de lettres ou de détenus de la prison de Loos. Des activités qui cherchent, modestement mais résolument, à inventer pour s’adapter à ces diversités.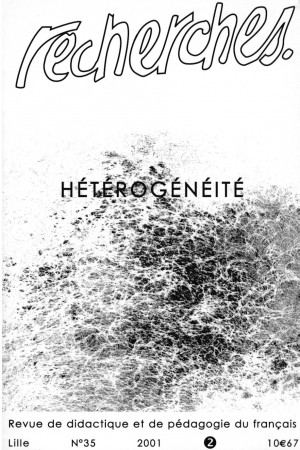 Qu’entend-on par hétérogénéité en maternelle, au CP, au collège ou au lycée ? Que peut apporter la rencontre entre une classe de 6e et une institutrice spécialisée messagère de sa classe d’IEM, entre deux classes d’un même collège, entre une école primaire et des enfants autistes ? Comment rend-on une classe homogène quand une classe dite « hétérogène » est une classe où les élèves ont du mal à vivre ensemble ? Des idées pour que le travail de groupes soit un outil d’apprentissage mais aussi un lieu où se travaille la relation à l’autre et à soi-même (ses difficultés mais aussi ses projets).
Qu’entend-on par hétérogénéité en maternelle, au CP, au collège ou au lycée ? Que peut apporter la rencontre entre une classe de 6e et une institutrice spécialisée messagère de sa classe d’IEM, entre deux classes d’un même collège, entre une école primaire et des enfants autistes ? Comment rend-on une classe homogène quand une classe dite « hétérogène » est une classe où les élèves ont du mal à vivre ensemble ? Des idées pour que le travail de groupes soit un outil d’apprentissage mais aussi un lieu où se travaille la relation à l’autre et à soi-même (ses difficultés mais aussi ses projets). Des propositions de travail sur des supports imagés très divers : un film, des affiches de film ou de pièces de théâtre, des illustrations de nouvelles, des images de Pef ou de Goya, des bandes dessinées… Se servir de l’image pour faire parler, pour apprendre à lire et à communiquer (article d’une équipe de l’institut de rééducation psychothérapeutique de Roubaix consacré à l’usage du pictogramme), pour se regarder (travail sur des présentations orales filmées en 3e d’insertion), pour comprendre d’autres images, pour faire écrire et inventer. Des points de vue sur l’image que les élèves ont et donnent d’eux-mêmes mais aussi des interrogations sur la pseudo-évidence de l’image et de son utilisation comme facilitateur d’apprentissage.
Des propositions de travail sur des supports imagés très divers : un film, des affiches de film ou de pièces de théâtre, des illustrations de nouvelles, des images de Pef ou de Goya, des bandes dessinées… Se servir de l’image pour faire parler, pour apprendre à lire et à communiquer (article d’une équipe de l’institut de rééducation psychothérapeutique de Roubaix consacré à l’usage du pictogramme), pour se regarder (travail sur des présentations orales filmées en 3e d’insertion), pour comprendre d’autres images, pour faire écrire et inventer. Des points de vue sur l’image que les élèves ont et donnent d’eux-mêmes mais aussi des interrogations sur la pseudo-évidence de l’image et de son utilisation comme facilitateur d’apprentissage. Comment faire avec les injonctions d’enseigner l’oral ? Analyses institutionnelles et propositions didactiques (collège, LP, école élémentaire, lycée) permettent d’y voir un peu plus clair. Cadres didactiques généraux sur la parole en classe et le travail sur l’oral. Parallèlement, on s’interroge sur les limites des pouvoirs de la didactique : objectifs du travail des orthophonistes, analyse des digressions dans le travail de groupe. Sont questionnés également certains aspects des relations oral/écrit.
Comment faire avec les injonctions d’enseigner l’oral ? Analyses institutionnelles et propositions didactiques (collège, LP, école élémentaire, lycée) permettent d’y voir un peu plus clair. Cadres didactiques généraux sur la parole en classe et le travail sur l’oral. Parallèlement, on s’interroge sur les limites des pouvoirs de la didactique : objectifs du travail des orthophonistes, analyse des digressions dans le travail de groupe. Sont questionnés également certains aspects des relations oral/écrit.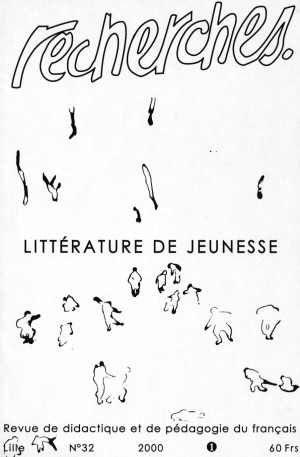 Depuis que la littérature de jeunes est entrée en classe, qu’est-elle devenue ? Comment continuer à innover avec les livres ou les albums en lecture et écriture sans céder à la banalisation scolaire ? Des démarches sont proposées pour le collège et les élèves en difficulté de l’école élémentaire. Peut-être faut-il aller aussi voir en dehors de la classe, dans les quartiers et auprès des parents, ou, dans le cadre des activités scolaires, emmener les élèves dans une « vraie » librairie, ouvrir le CDI à de « vrais » auteurs. Pour finir, il est également intéressant de s’informer sur l’édition (comment évolue-t-elle ? qu’en disent les éditeurs ?).
Depuis que la littérature de jeunes est entrée en classe, qu’est-elle devenue ? Comment continuer à innover avec les livres ou les albums en lecture et écriture sans céder à la banalisation scolaire ? Des démarches sont proposées pour le collège et les élèves en difficulté de l’école élémentaire. Peut-être faut-il aller aussi voir en dehors de la classe, dans les quartiers et auprès des parents, ou, dans le cadre des activités scolaires, emmener les élèves dans une « vraie » librairie, ouvrir le CDI à de « vrais » auteurs. Pour finir, il est également intéressant de s’informer sur l’édition (comment évolue-t-elle ? qu’en disent les éditeurs ?).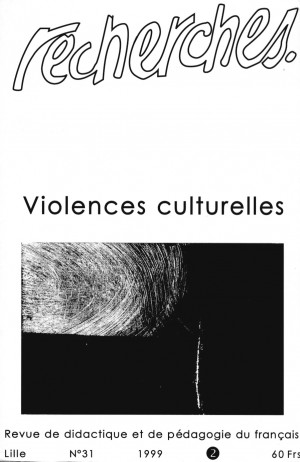 Violences ordinaires des institutions sur l’individu (élève, enseignant, parent) ; violences des valeurs non partagées (le passage 3e/2nde et la découverte d’un nouveau monde, où l’on découvre qu’appliquer une consigne d’écriture ne suffit pas à séduire le professeur), violence de la culture que le professeur/l’élève vit comme étrangère, violence de l’écrit sur l’oral, violence de la distance entre qui enseigne et qui apprend. Comme à l’habitude, les articles portent sur le collège, le LEGT et le LP, les classes spécialisées de l’école élémentaire, et même la formation initiale des enseignants !
Violences ordinaires des institutions sur l’individu (élève, enseignant, parent) ; violences des valeurs non partagées (le passage 3e/2nde et la découverte d’un nouveau monde, où l’on découvre qu’appliquer une consigne d’écriture ne suffit pas à séduire le professeur), violence de la culture que le professeur/l’élève vit comme étrangère, violence de l’écrit sur l’oral, violence de la distance entre qui enseigne et qui apprend. Comme à l’habitude, les articles portent sur le collège, le LEGT et le LP, les classes spécialisées de l’école élémentaire, et même la formation initiale des enseignants ! Parler des textes qui nous parlent (du monde et d’autre chose) en fuyant le commentaire techniciste. De l’apprentissage de la compréhension au CP à la critique littéraire au lycée. Et entre deux, de nombreux exemples au collège et au LP, ainsi qu’en classe d’adaptation, de situations de parole autour des textes qu’on lit mais qu’on ne cherche pas à « commenter ». Une mise au point théorique sur la notion de lecture littéraire.
Parler des textes qui nous parlent (du monde et d’autre chose) en fuyant le commentaire techniciste. De l’apprentissage de la compréhension au CP à la critique littéraire au lycée. Et entre deux, de nombreux exemples au collège et au LP, ainsi qu’en classe d’adaptation, de situations de parole autour des textes qu’on lit mais qu’on ne cherche pas à « commenter ». Une mise au point théorique sur la notion de lecture littéraire.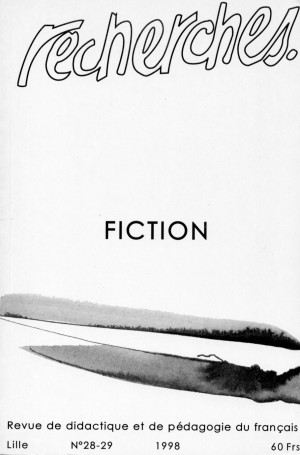 Des relations (paradoxales) entre fiction et réalité, ou comment, en classe, jouer avec (contre ?) le pouvoir des fictions. De nombreuses propositions didactiques (parfois quasi philosophiques) autour de l’écriture de fiction en collège, et d’autres (quasi sociologiques) autour de la lecture de textes fictionnels en LP (dont une nouvelle inédite de P. Boulle). Travail sur l’image en 3e, sur l’élaboration de récits d’énigme, sur la compréhension, en 2nde, de textes reposant sur l’opposition réalité/fiction.
Des relations (paradoxales) entre fiction et réalité, ou comment, en classe, jouer avec (contre ?) le pouvoir des fictions. De nombreuses propositions didactiques (parfois quasi philosophiques) autour de l’écriture de fiction en collège, et d’autres (quasi sociologiques) autour de la lecture de textes fictionnels en LP (dont une nouvelle inédite de P. Boulle). Travail sur l’image en 3e, sur l’élaboration de récits d’énigme, sur la compréhension, en 2nde, de textes reposant sur l’opposition réalité/fiction.