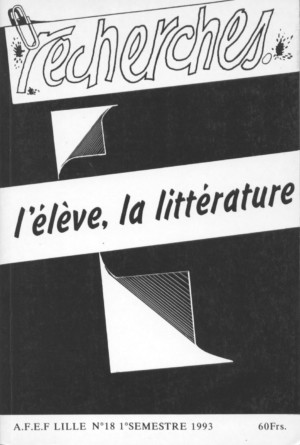Parler des textes qui nous parlent (du monde et d’autre chose) en fuyant le commentaire techniciste. De l’apprentissage de la compréhension au CP à la critique littéraire au lycée. Et entre deux, de nombreux exemples au collège et au LP, ainsi qu’en classe d’adaptation, de situations de parole autour des textes qu’on lit mais qu’on ne cherche pas à « commenter ». Une mise au point théorique sur la notion de lecture littéraire.
Parler des textes qui nous parlent (du monde et d’autre chose) en fuyant le commentaire techniciste. De l’apprentissage de la compréhension au CP à la critique littéraire au lycée. Et entre deux, de nombreux exemples au collège et au LP, ainsi qu’en classe d’adaptation, de situations de parole autour des textes qu’on lit mais qu’on ne cherche pas à « commenter ». Une mise au point théorique sur la notion de lecture littéraire.
Le numéro est en vente sur notre site. Les articles sont téléchargeables sur cette page.
Sommaire
Découvrir la littérature de jeunesse / I. Lempens 9
La « lecture littéraire » : les risques d’une mystification / B. Daunay 29
« C’est quoi c’t mec ? Y a fumé la moquette ? » Paroles d’élèves sur un texte / K. Serlet 61
Le procès de Naïs / M. Calonne 75
Enjeux des activités métacognitives dans les premiers apprentissages de lecture et de compréhension de textes / M. Pagoni 91
Je cible un livre, je l’inspecte, je le lis, et hop : je le fiche. Je suis acteur au CDI / L. Godbille 121
Lire et parler des textes : parole prescrite/parole réelle – textes muets/textes bavards / S. Suffys 133
Des mondes à construire, des textes à explorer / M.-M. Cauterman 165
Produire des critiques littéraires / N. Denizot, C. Mercier 193
Quand le dégout devient moteur : la réécriture comme lecture / L. Godbille 211
Des miettes de sens aux paroles sur les textes : une utopie ? / M. Constant 229
Des nouvelles du livre pour la jeunesse : le sida / É. Vlieghe 253
Éditorial
Naguère, par les textes, l’élève était conduit sur le chemin du panthéon, sommé de se hisser jusqu’au beau. Quasi l’ineffable. D’ailleurs, beaucoup en cours de route en perdaient la voix. Par chance, l’école ne les engageait pas tous sur cette route difficile : il y avait bifurcations et impasses dont seuls se tiraient ses sujets les plus méritants, ou plutôt, les plus dignes.
Aujourd’hui, l’élève reçoit l’injonction de traquer dans les textes, pour les nommer, champs lexicaux, avatars du schéma actanciel et figures de style protéiformes. Ces mots d’allure savante qui résonnent dans le maquis des techniques d’écriture masquent difficilement son silence. Une telle approche pourrait pourtant laisser croire que l’enjeu est de rendre enseignables les Belles Lettres en en faisant des objets de savoir, et donc de discours, identifiés et identifiables […]
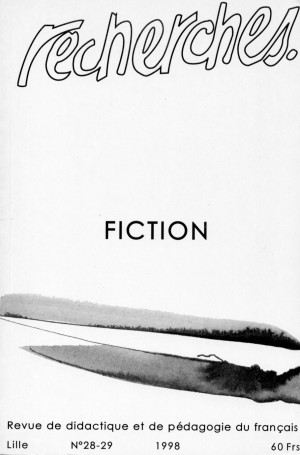 Des relations (paradoxales) entre fiction et réalité, ou comment, en classe, jouer avec (contre ?) le pouvoir des fictions. De nombreuses propositions didactiques (parfois quasi philosophiques) autour de l’écriture de fiction en collège, et d’autres (quasi sociologiques) autour de la lecture de textes fictionnels en LP (dont une nouvelle inédite de P. Boulle). Travail sur l’image en 3e, sur l’élaboration de récits d’énigme, sur la compréhension, en 2nde, de textes reposant sur l’opposition réalité/fiction.
Des relations (paradoxales) entre fiction et réalité, ou comment, en classe, jouer avec (contre ?) le pouvoir des fictions. De nombreuses propositions didactiques (parfois quasi philosophiques) autour de l’écriture de fiction en collège, et d’autres (quasi sociologiques) autour de la lecture de textes fictionnels en LP (dont une nouvelle inédite de P. Boulle). Travail sur l’image en 3e, sur l’élaboration de récits d’énigme, sur la compréhension, en 2nde, de textes reposant sur l’opposition réalité/fiction.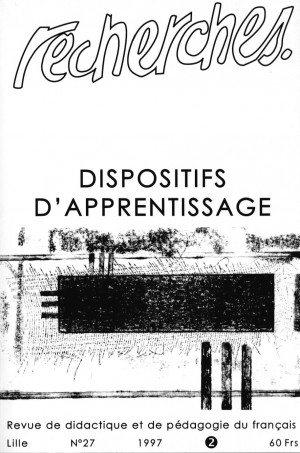 Le détail de la gestion de la classe. Faire classe, c’est d’abord se demander ce qu’auront effectivement à faire les élèves, décider des moyens, des dispositions (matérielles, spatiales, temporelles), des groupements qui faciliteront les apprentissages. Comment mettre les élèves au travail ? Quelles consignes leur donner ? Comment enseigner avec des copies ? Comment faire réfléchir sur le travail, l’école, le travail en groupes, l’écriture ? Des analyses et des propositions didactiques.
Le détail de la gestion de la classe. Faire classe, c’est d’abord se demander ce qu’auront effectivement à faire les élèves, décider des moyens, des dispositions (matérielles, spatiales, temporelles), des groupements qui faciliteront les apprentissages. Comment mettre les élèves au travail ? Quelles consignes leur donner ? Comment enseigner avec des copies ? Comment faire réfléchir sur le travail, l’école, le travail en groupes, l’écriture ? Des analyses et des propositions didactiques.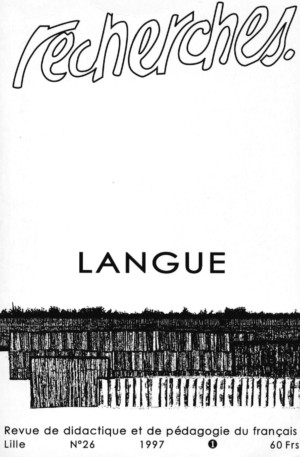
 Les apprentissages premiers : origines des échecs en lecture ? Que faire lire aux élèves en difficulté ? Au collège : quelles aides pour développer la compréhension (SEGPA) ? Lire de la littérature de jeunesse ? Lire en 3e d’insertion ? Au lycée, lecture intégrale en terminale L et en bac pro. La lecture à l’école maternelle : une histoire de partenariat école/familles.
Les apprentissages premiers : origines des échecs en lecture ? Que faire lire aux élèves en difficulté ? Au collège : quelles aides pour développer la compréhension (SEGPA) ? Lire de la littérature de jeunesse ? Lire en 3e d’insertion ? Au lycée, lecture intégrale en terminale L et en bac pro. La lecture à l’école maternelle : une histoire de partenariat école/familles.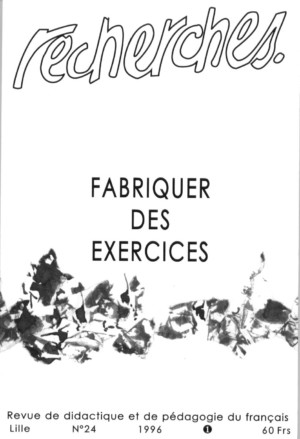 Les exercices sont-ils utiles ? Suffit-il d’exercices pour que les élèves apprennent ? Aux élèves en grande difficulté, peut-on seulement proposer des exercices ? Pour alimenter ces interrogations, des propositions sur l’argumentation (LP, Lycée), le vocabulaire au brevet, discours direct/indirect, les pratiques de lecture en 3e, les activités de tri (CP) et la production de textes.
Les exercices sont-ils utiles ? Suffit-il d’exercices pour que les élèves apprennent ? Aux élèves en grande difficulté, peut-on seulement proposer des exercices ? Pour alimenter ces interrogations, des propositions sur l’argumentation (LP, Lycée), le vocabulaire au brevet, discours direct/indirect, les pratiques de lecture en 3e, les activités de tri (CP) et la production de textes.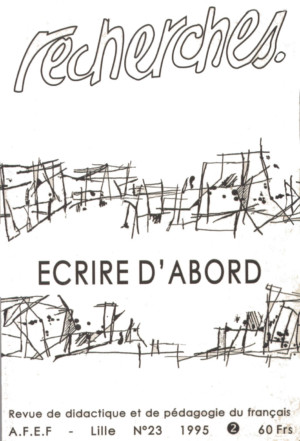 Écrire en groupe (collège), en projet (SEGPA), avec un ordinateur (collège, cycée). Faire écrire des élèves en grande difficulté (école élémentaire, collège). Écrire pour apprendre (collège). Et le « sujet écrivant » ? Qu’est-ce qu’un « bon texte » pour des élèves de LP ? Le paragraphe argumentatif, une impasse didactique. Typologie d’activités autour du narratif.
Écrire en groupe (collège), en projet (SEGPA), avec un ordinateur (collège, cycée). Faire écrire des élèves en grande difficulté (école élémentaire, collège). Écrire pour apprendre (collège). Et le « sujet écrivant » ? Qu’est-ce qu’un « bon texte » pour des élèves de LP ? Le paragraphe argumentatif, une impasse didactique. Typologie d’activités autour du narratif.
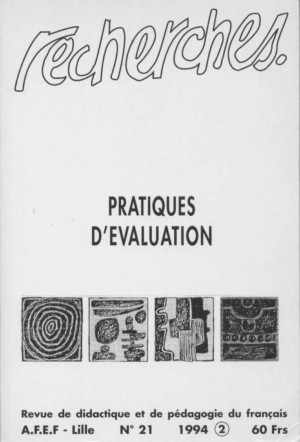 Les avatars de l’évaluation critériée, l’impossible objectivité de la note, la difficulté de proposer des remédiations en production écrite. Évaluer avec ou sans grilles (des récits, des résumés, des commentaires, des dissertations) mais aussi apprendre aux élèves à évaluer. Bibliographie.
Les avatars de l’évaluation critériée, l’impossible objectivité de la note, la difficulté de proposer des remédiations en production écrite. Évaluer avec ou sans grilles (des récits, des résumés, des commentaires, des dissertations) mais aussi apprendre aux élèves à évaluer. Bibliographie.