 Des propositions de travail sur des supports imagés très divers : un film, des affiches de film ou de pièces de théâtre, des illustrations de nouvelles, des images de Pef ou de Goya, des bandes dessinées… Se servir de l’image pour faire parler, pour apprendre à lire et à communiquer (article d’une équipe de l’institut de rééducation psychothérapeutique de Roubaix consacré à l’usage du pictogramme), pour se regarder (travail sur des présentations orales filmées en 3e d’insertion), pour comprendre d’autres images, pour faire écrire et inventer. Des points de vue sur l’image que les élèves ont et donnent d’eux-mêmes mais aussi des interrogations sur la pseudo-évidence de l’image et de son utilisation comme facilitateur d’apprentissage.
Des propositions de travail sur des supports imagés très divers : un film, des affiches de film ou de pièces de théâtre, des illustrations de nouvelles, des images de Pef ou de Goya, des bandes dessinées… Se servir de l’image pour faire parler, pour apprendre à lire et à communiquer (article d’une équipe de l’institut de rééducation psychothérapeutique de Roubaix consacré à l’usage du pictogramme), pour se regarder (travail sur des présentations orales filmées en 3e d’insertion), pour comprendre d’autres images, pour faire écrire et inventer. Des points de vue sur l’image que les élèves ont et donnent d’eux-mêmes mais aussi des interrogations sur la pseudo-évidence de l’image et de son utilisation comme facilitateur d’apprentissage.
Le numéro est en vente sur notre site.
Les articles sont téléchargeables sur cette page.
Sommaire
Image de soi, oral et vidéo / L. Godbille 7
Le freak, c’est chic ! / M. Habi 15
Pas besoin de leur faire un dessin : quelques réflexions à propos de ces petits dessins qui, normalement, valent mieux qu’un long discours / Ch. Deneuville, Patrice Heems 35
Champ/contre-champ sur l’image et le texte littéraire en classe de 4e : lectures du fantastique / J.-P. Hannecart 41
Le choc des images ou la vérité sort de la bouche de Marcel / L. Godbille 63
Travailler dans les classes avec le photolangage / N. Bliez-Sutterot 65
Quatre images pour une séquence / D. Fabé 81
Communiquer et apprendre à l’aide du pictogramme / O. Gaffez, V. Ketels, K. Khiter, C. Monnier, P. Turbot, 99
L’image réfléchie des élèves / M.-F. Desprez 111
Des images molles aux traces du langage. Du langage imagé aux images qui parlent / S. Suffys, M. Ternoy 121
Image, attention à la noyade / A. Achille 191
Trafic d’affiches / K. Serlet, G. Bochaton 197
Bande dessinée et genre policier en classe de seconde / N. Denizot, C. Mercier 227
Des nouvelles du livre pour la jeunesse : le vampire (1) / É. Vlieghe
Éditorial
Qu’est-ce qui a conduit le comité de rédaction de Recherches à consacrer un numéro de la revue à l’image ? Tentation de la mode ? Après l’oral, la littérature de jeunesse, autres thèmes particulièrement branchés, l’image serait-elle un sujet très tendance ? Si telle était notre motivation, il faut bien dire que nous serions un peu décalés : voilà de nombreuses années désormais que cette « mode » sévit, sinon dans les pratiques majoritaires, du moins dans les injonctions officielles comme dans les manuels qui cherchent consciencieusement à obéir à ces dernières…
La motivation de ce numéro est évidemment ailleurs : l’enseignement de l’image en cours de français a désormais une histoire suffisamment longue pour qu’on puisse exercer un regard critique sur les effets didactiques et pédagogiques de cette injonction institutionnelle. […]
 Comment faire avec les injonctions d’enseigner l’oral ? Analyses institutionnelles et propositions didactiques (collège, LP, école élémentaire, lycée) permettent d’y voir un peu plus clair. Cadres didactiques généraux sur la parole en classe et le travail sur l’oral. Parallèlement, on s’interroge sur les limites des pouvoirs de la didactique : objectifs du travail des orthophonistes, analyse des digressions dans le travail de groupe. Sont questionnés également certains aspects des relations oral/écrit.
Comment faire avec les injonctions d’enseigner l’oral ? Analyses institutionnelles et propositions didactiques (collège, LP, école élémentaire, lycée) permettent d’y voir un peu plus clair. Cadres didactiques généraux sur la parole en classe et le travail sur l’oral. Parallèlement, on s’interroge sur les limites des pouvoirs de la didactique : objectifs du travail des orthophonistes, analyse des digressions dans le travail de groupe. Sont questionnés également certains aspects des relations oral/écrit.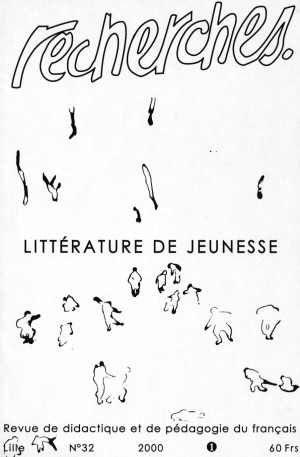 Depuis que la littérature de jeunes est entrée en classe, qu’est-elle devenue ? Comment continuer à innover avec les livres ou les albums en lecture et écriture sans céder à la banalisation scolaire ? Des démarches sont proposées pour le collège et les élèves en difficulté de l’école élémentaire. Peut-être faut-il aller aussi voir en dehors de la classe, dans les quartiers et auprès des parents, ou, dans le cadre des activités scolaires, emmener les élèves dans une « vraie » librairie, ouvrir le CDI à de « vrais » auteurs. Pour finir, il est également intéressant de s’informer sur l’édition (comment évolue-t-elle ? qu’en disent les éditeurs ?).
Depuis que la littérature de jeunes est entrée en classe, qu’est-elle devenue ? Comment continuer à innover avec les livres ou les albums en lecture et écriture sans céder à la banalisation scolaire ? Des démarches sont proposées pour le collège et les élèves en difficulté de l’école élémentaire. Peut-être faut-il aller aussi voir en dehors de la classe, dans les quartiers et auprès des parents, ou, dans le cadre des activités scolaires, emmener les élèves dans une « vraie » librairie, ouvrir le CDI à de « vrais » auteurs. Pour finir, il est également intéressant de s’informer sur l’édition (comment évolue-t-elle ? qu’en disent les éditeurs ?).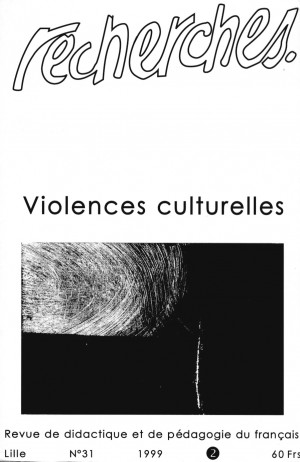 Violences ordinaires des institutions sur l’individu (élève, enseignant, parent) ; violences des valeurs non partagées (le passage 3e/2nde et la découverte d’un nouveau monde, où l’on découvre qu’appliquer une consigne d’écriture ne suffit pas à séduire le professeur), violence de la culture que le professeur/l’élève vit comme étrangère, violence de l’écrit sur l’oral, violence de la distance entre qui enseigne et qui apprend. Comme à l’habitude, les articles portent sur le collège, le LEGT et le LP, les classes spécialisées de l’école élémentaire, et même la formation initiale des enseignants !
Violences ordinaires des institutions sur l’individu (élève, enseignant, parent) ; violences des valeurs non partagées (le passage 3e/2nde et la découverte d’un nouveau monde, où l’on découvre qu’appliquer une consigne d’écriture ne suffit pas à séduire le professeur), violence de la culture que le professeur/l’élève vit comme étrangère, violence de l’écrit sur l’oral, violence de la distance entre qui enseigne et qui apprend. Comme à l’habitude, les articles portent sur le collège, le LEGT et le LP, les classes spécialisées de l’école élémentaire, et même la formation initiale des enseignants ! Parler des textes qui nous parlent (du monde et d’autre chose) en fuyant le commentaire techniciste. De l’apprentissage de la compréhension au CP à la critique littéraire au lycée. Et entre deux, de nombreux exemples au collège et au LP, ainsi qu’en classe d’adaptation, de situations de parole autour des textes qu’on lit mais qu’on ne cherche pas à « commenter ». Une mise au point théorique sur la notion de lecture littéraire.
Parler des textes qui nous parlent (du monde et d’autre chose) en fuyant le commentaire techniciste. De l’apprentissage de la compréhension au CP à la critique littéraire au lycée. Et entre deux, de nombreux exemples au collège et au LP, ainsi qu’en classe d’adaptation, de situations de parole autour des textes qu’on lit mais qu’on ne cherche pas à « commenter ». Une mise au point théorique sur la notion de lecture littéraire.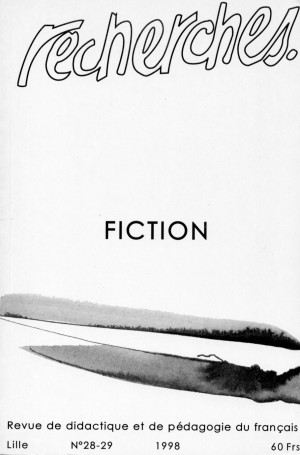 Des relations (paradoxales) entre fiction et réalité, ou comment, en classe, jouer avec (contre ?) le pouvoir des fictions. De nombreuses propositions didactiques (parfois quasi philosophiques) autour de l’écriture de fiction en collège, et d’autres (quasi sociologiques) autour de la lecture de textes fictionnels en LP (dont une nouvelle inédite de P. Boulle). Travail sur l’image en 3e, sur l’élaboration de récits d’énigme, sur la compréhension, en 2nde, de textes reposant sur l’opposition réalité/fiction.
Des relations (paradoxales) entre fiction et réalité, ou comment, en classe, jouer avec (contre ?) le pouvoir des fictions. De nombreuses propositions didactiques (parfois quasi philosophiques) autour de l’écriture de fiction en collège, et d’autres (quasi sociologiques) autour de la lecture de textes fictionnels en LP (dont une nouvelle inédite de P. Boulle). Travail sur l’image en 3e, sur l’élaboration de récits d’énigme, sur la compréhension, en 2nde, de textes reposant sur l’opposition réalité/fiction.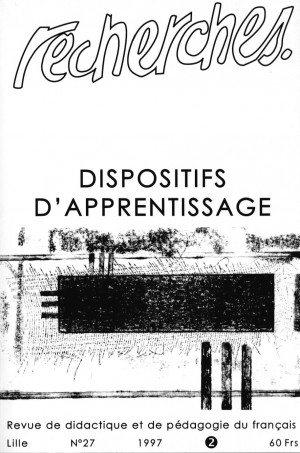 Le détail de la gestion de la classe. Faire classe, c’est d’abord se demander ce qu’auront effectivement à faire les élèves, décider des moyens, des dispositions (matérielles, spatiales, temporelles), des groupements qui faciliteront les apprentissages. Comment mettre les élèves au travail ? Quelles consignes leur donner ? Comment enseigner avec des copies ? Comment faire réfléchir sur le travail, l’école, le travail en groupes, l’écriture ? Des analyses et des propositions didactiques.
Le détail de la gestion de la classe. Faire classe, c’est d’abord se demander ce qu’auront effectivement à faire les élèves, décider des moyens, des dispositions (matérielles, spatiales, temporelles), des groupements qui faciliteront les apprentissages. Comment mettre les élèves au travail ? Quelles consignes leur donner ? Comment enseigner avec des copies ? Comment faire réfléchir sur le travail, l’école, le travail en groupes, l’écriture ? Des analyses et des propositions didactiques.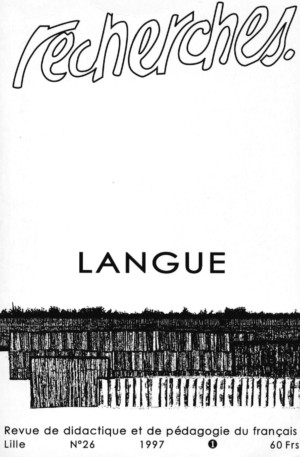
 Les apprentissages premiers : origines des échecs en lecture ? Que faire lire aux élèves en difficulté ? Au collège : quelles aides pour développer la compréhension (SEGPA) ? Lire de la littérature de jeunesse ? Lire en 3e d’insertion ? Au lycée, lecture intégrale en terminale L et en bac pro. La lecture à l’école maternelle : une histoire de partenariat école/familles.
Les apprentissages premiers : origines des échecs en lecture ? Que faire lire aux élèves en difficulté ? Au collège : quelles aides pour développer la compréhension (SEGPA) ? Lire de la littérature de jeunesse ? Lire en 3e d’insertion ? Au lycée, lecture intégrale en terminale L et en bac pro. La lecture à l’école maternelle : une histoire de partenariat école/familles.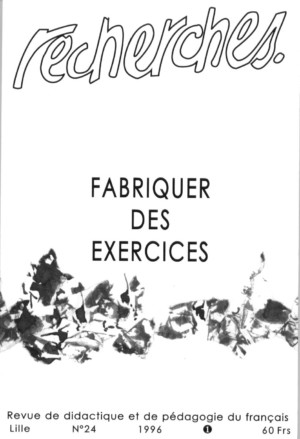 Les exercices sont-ils utiles ? Suffit-il d’exercices pour que les élèves apprennent ? Aux élèves en grande difficulté, peut-on seulement proposer des exercices ? Pour alimenter ces interrogations, des propositions sur l’argumentation (LP, Lycée), le vocabulaire au brevet, discours direct/indirect, les pratiques de lecture en 3e, les activités de tri (CP) et la production de textes.
Les exercices sont-ils utiles ? Suffit-il d’exercices pour que les élèves apprennent ? Aux élèves en grande difficulté, peut-on seulement proposer des exercices ? Pour alimenter ces interrogations, des propositions sur l’argumentation (LP, Lycée), le vocabulaire au brevet, discours direct/indirect, les pratiques de lecture en 3e, les activités de tri (CP) et la production de textes.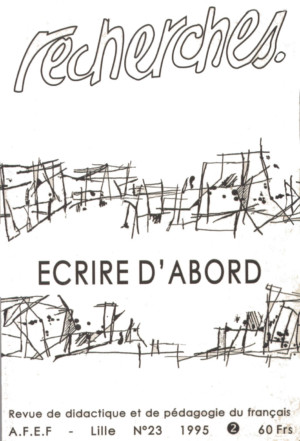 Écrire en groupe (collège), en projet (SEGPA), avec un ordinateur (collège, cycée). Faire écrire des élèves en grande difficulté (école élémentaire, collège). Écrire pour apprendre (collège). Et le « sujet écrivant » ? Qu’est-ce qu’un « bon texte » pour des élèves de LP ? Le paragraphe argumentatif, une impasse didactique. Typologie d’activités autour du narratif.
Écrire en groupe (collège), en projet (SEGPA), avec un ordinateur (collège, cycée). Faire écrire des élèves en grande difficulté (école élémentaire, collège). Écrire pour apprendre (collège). Et le « sujet écrivant » ? Qu’est-ce qu’un « bon texte » pour des élèves de LP ? Le paragraphe argumentatif, une impasse didactique. Typologie d’activités autour du narratif.