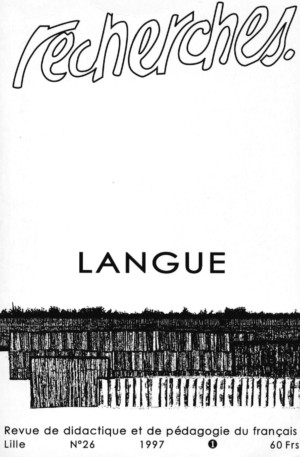Des évaluations nationales en CE2, en 6e, en 5e, en 2nde qui viennent s’ajouter aux examens : d’où vient cette systématisation de l’évaluation au niveau institutionnel et avec quels effets dans les classes ? Des articles qui tentent de cerner certaines impasses des formes institutionnelles d’évaluation du côté des enseignants – quand les cahiers d’évaluations ne sont pas exploitables, quand les résultats des évaluations nationales stigmatisent toujours les mêmes classes, des mêmes établissements – mais aussi du côté des élèves – de l’opacité, voire de la violence que représentent pour les élèves les évaluations nationales, les examens, voire l’évaluation en général. Qu’en faire ? des propositions de rémédiation à partir des évaluations nationales mais aussi l’élaboration d’autres évaluations adaptées à un public donné et ciblé – des enfants à risques de difficultés scolaires en maternelle, un élève primo-arrivant, etc. Quelques réflexions et propositions didactiques pour préparer les examens en français (brevet et baccalauréat), frontalement ou de biais.
Des évaluations nationales en CE2, en 6e, en 5e, en 2nde qui viennent s’ajouter aux examens : d’où vient cette systématisation de l’évaluation au niveau institutionnel et avec quels effets dans les classes ? Des articles qui tentent de cerner certaines impasses des formes institutionnelles d’évaluation du côté des enseignants – quand les cahiers d’évaluations ne sont pas exploitables, quand les résultats des évaluations nationales stigmatisent toujours les mêmes classes, des mêmes établissements – mais aussi du côté des élèves – de l’opacité, voire de la violence que représentent pour les élèves les évaluations nationales, les examens, voire l’évaluation en général. Qu’en faire ? des propositions de rémédiation à partir des évaluations nationales mais aussi l’élaboration d’autres évaluations adaptées à un public donné et ciblé – des enfants à risques de difficultés scolaires en maternelle, un élève primo-arrivant, etc. Quelques réflexions et propositions didactiques pour préparer les examens en français (brevet et baccalauréat), frontalement ou de biais.
Le numéro est en vente sur notre site. Les articles sont téléchargeables sur cette page.
Sommaire
Les évaluations en 6e : les difficultés de traduction d’une politique nationale / D. Chazal et R. Normand 9
On a encore perdu aux évaluations / P. Heems 21
Quand les élèves disent non à l’évaluation / M. Bleuse 27
Les élèves face à l’évaluation : de l’imprévisibilité à l’opacité / A. Barrère 43
Élèves inévaluables / F. Darras 61
Puis-je évaluer ? / M.-F. Desprez 93
Rapport d’étape d’une recherche action dépistage et suivi d’enfants à risques de difficultés scolaires dès trois ans 10 mois / D. Crunelle, A. Dubus, M-C. Dubus, G. Licour, M-F. Godon 105
Comment construire une évaluation : histoire d’un bricolage / A. Decottignies 139
Quelques représentations de l’EAF chez des élèves de seconde / N. Denizot 149
Oui, mais le brevet ? / M.-M. Cauterman 153
Produire un parascolaire en seconde : un premier pas vers le bac / N. Denizot, C. Mercier 163
Le commentaire et la dissertation dans Recherches / C. Coget 187
Des nouvelles du livre pour la jeunesse : utopies et totalitarisme / É. Vlieghe 213
Éditorial
L’évaluation de l’élève dans le système scolaire relève le plus souvent de la relation pédagogique entre l’élève et l’enseignant : dans une situation d’apprentissage, l’évaluation (qu’elle soit diagnostique, formatrice, sommative, pour s’en tenir à une trilogie entrée dans les usages terminologiques partagés par la communauté éducative) est une affaire entre l’apprenant et l’enseignant, qui ne cesse, implicitement ou explicitement, avec ou sans notation, au su ou à l’insu de l’élève, d’évaluer ce dernier. Mais l’évaluation est aussi le fait de l’institution, qui porte régulièrement un regard sur les élèves, en enlevant à l’enseignant tout ou partie de la maîtrise de l’évaluation, lors des examens ou des évaluations à l’entrée de certaines classes. […]
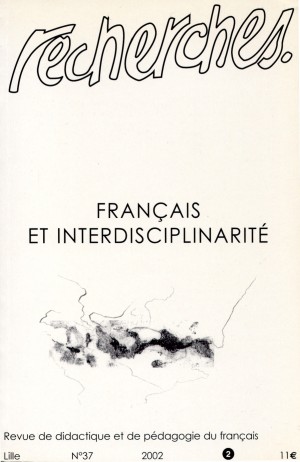
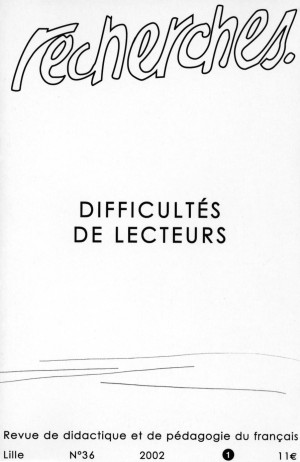 Quelles réalités se cachent derrière le trop fameux « ils ne savent pas lire » ? À la différence du n° 17, ce numéro est davantage centré sur l’apprenant et il est serti de multiples portraits de non-lecteurs mais aussi de lecteurs, pour essayer de mieux cerner la diversité des modes d’appropriation de l’écrit et des conditions qui rendent cette appropriation possible, parmi lesquelles la peur d’apprendre et le rôle de la médiation culturelle. Diversité également des publics évoqués puisque les difficultés ou les horizons de lecture présentés sont, entre autres, celles d’élèves d’école primaire, de 6e en REP, de BTS en chaudronnerie, d’un étudiant en faculté de lettres ou de détenus de la prison de Loos. Des activités qui cherchent, modestement mais résolument, à inventer pour s’adapter à ces diversités.
Quelles réalités se cachent derrière le trop fameux « ils ne savent pas lire » ? À la différence du n° 17, ce numéro est davantage centré sur l’apprenant et il est serti de multiples portraits de non-lecteurs mais aussi de lecteurs, pour essayer de mieux cerner la diversité des modes d’appropriation de l’écrit et des conditions qui rendent cette appropriation possible, parmi lesquelles la peur d’apprendre et le rôle de la médiation culturelle. Diversité également des publics évoqués puisque les difficultés ou les horizons de lecture présentés sont, entre autres, celles d’élèves d’école primaire, de 6e en REP, de BTS en chaudronnerie, d’un étudiant en faculté de lettres ou de détenus de la prison de Loos. Des activités qui cherchent, modestement mais résolument, à inventer pour s’adapter à ces diversités.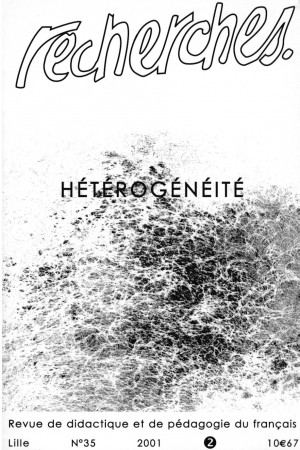 Qu’entend-on par hétérogénéité en maternelle, au CP, au collège ou au lycée ? Que peut apporter la rencontre entre une classe de 6e et une institutrice spécialisée messagère de sa classe d’IEM, entre deux classes d’un même collège, entre une école primaire et des enfants autistes ? Comment rend-on une classe homogène quand une classe dite « hétérogène » est une classe où les élèves ont du mal à vivre ensemble ? Des idées pour que le travail de groupes soit un outil d’apprentissage mais aussi un lieu où se travaille la relation à l’autre et à soi-même (ses difficultés mais aussi ses projets).
Qu’entend-on par hétérogénéité en maternelle, au CP, au collège ou au lycée ? Que peut apporter la rencontre entre une classe de 6e et une institutrice spécialisée messagère de sa classe d’IEM, entre deux classes d’un même collège, entre une école primaire et des enfants autistes ? Comment rend-on une classe homogène quand une classe dite « hétérogène » est une classe où les élèves ont du mal à vivre ensemble ? Des idées pour que le travail de groupes soit un outil d’apprentissage mais aussi un lieu où se travaille la relation à l’autre et à soi-même (ses difficultés mais aussi ses projets). Des propositions de travail sur des supports imagés très divers : un film, des affiches de film ou de pièces de théâtre, des illustrations de nouvelles, des images de Pef ou de Goya, des bandes dessinées… Se servir de l’image pour faire parler, pour apprendre à lire et à communiquer (article d’une équipe de l’institut de rééducation psychothérapeutique de Roubaix consacré à l’usage du pictogramme), pour se regarder (travail sur des présentations orales filmées en 3e d’insertion), pour comprendre d’autres images, pour faire écrire et inventer. Des points de vue sur l’image que les élèves ont et donnent d’eux-mêmes mais aussi des interrogations sur la pseudo-évidence de l’image et de son utilisation comme facilitateur d’apprentissage.
Des propositions de travail sur des supports imagés très divers : un film, des affiches de film ou de pièces de théâtre, des illustrations de nouvelles, des images de Pef ou de Goya, des bandes dessinées… Se servir de l’image pour faire parler, pour apprendre à lire et à communiquer (article d’une équipe de l’institut de rééducation psychothérapeutique de Roubaix consacré à l’usage du pictogramme), pour se regarder (travail sur des présentations orales filmées en 3e d’insertion), pour comprendre d’autres images, pour faire écrire et inventer. Des points de vue sur l’image que les élèves ont et donnent d’eux-mêmes mais aussi des interrogations sur la pseudo-évidence de l’image et de son utilisation comme facilitateur d’apprentissage. Comment faire avec les injonctions d’enseigner l’oral ? Analyses institutionnelles et propositions didactiques (collège, LP, école élémentaire, lycée) permettent d’y voir un peu plus clair. Cadres didactiques généraux sur la parole en classe et le travail sur l’oral. Parallèlement, on s’interroge sur les limites des pouvoirs de la didactique : objectifs du travail des orthophonistes, analyse des digressions dans le travail de groupe. Sont questionnés également certains aspects des relations oral/écrit.
Comment faire avec les injonctions d’enseigner l’oral ? Analyses institutionnelles et propositions didactiques (collège, LP, école élémentaire, lycée) permettent d’y voir un peu plus clair. Cadres didactiques généraux sur la parole en classe et le travail sur l’oral. Parallèlement, on s’interroge sur les limites des pouvoirs de la didactique : objectifs du travail des orthophonistes, analyse des digressions dans le travail de groupe. Sont questionnés également certains aspects des relations oral/écrit.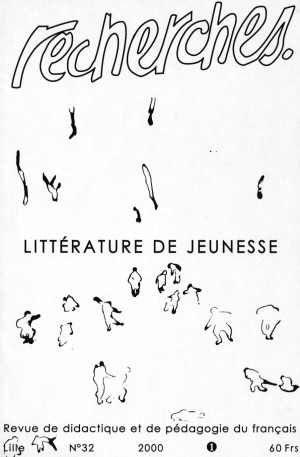 Depuis que la littérature de jeunes est entrée en classe, qu’est-elle devenue ? Comment continuer à innover avec les livres ou les albums en lecture et écriture sans céder à la banalisation scolaire ? Des démarches sont proposées pour le collège et les élèves en difficulté de l’école élémentaire. Peut-être faut-il aller aussi voir en dehors de la classe, dans les quartiers et auprès des parents, ou, dans le cadre des activités scolaires, emmener les élèves dans une « vraie » librairie, ouvrir le CDI à de « vrais » auteurs. Pour finir, il est également intéressant de s’informer sur l’édition (comment évolue-t-elle ? qu’en disent les éditeurs ?).
Depuis que la littérature de jeunes est entrée en classe, qu’est-elle devenue ? Comment continuer à innover avec les livres ou les albums en lecture et écriture sans céder à la banalisation scolaire ? Des démarches sont proposées pour le collège et les élèves en difficulté de l’école élémentaire. Peut-être faut-il aller aussi voir en dehors de la classe, dans les quartiers et auprès des parents, ou, dans le cadre des activités scolaires, emmener les élèves dans une « vraie » librairie, ouvrir le CDI à de « vrais » auteurs. Pour finir, il est également intéressant de s’informer sur l’édition (comment évolue-t-elle ? qu’en disent les éditeurs ?).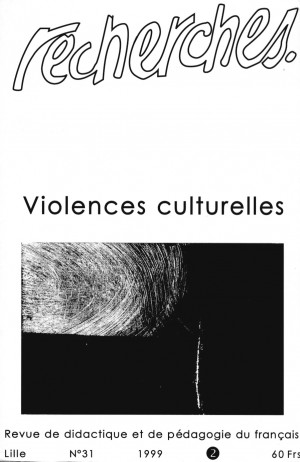 Violences ordinaires des institutions sur l’individu (élève, enseignant, parent) ; violences des valeurs non partagées (le passage 3e/2nde et la découverte d’un nouveau monde, où l’on découvre qu’appliquer une consigne d’écriture ne suffit pas à séduire le professeur), violence de la culture que le professeur/l’élève vit comme étrangère, violence de l’écrit sur l’oral, violence de la distance entre qui enseigne et qui apprend. Comme à l’habitude, les articles portent sur le collège, le LEGT et le LP, les classes spécialisées de l’école élémentaire, et même la formation initiale des enseignants !
Violences ordinaires des institutions sur l’individu (élève, enseignant, parent) ; violences des valeurs non partagées (le passage 3e/2nde et la découverte d’un nouveau monde, où l’on découvre qu’appliquer une consigne d’écriture ne suffit pas à séduire le professeur), violence de la culture que le professeur/l’élève vit comme étrangère, violence de l’écrit sur l’oral, violence de la distance entre qui enseigne et qui apprend. Comme à l’habitude, les articles portent sur le collège, le LEGT et le LP, les classes spécialisées de l’école élémentaire, et même la formation initiale des enseignants ! Parler des textes qui nous parlent (du monde et d’autre chose) en fuyant le commentaire techniciste. De l’apprentissage de la compréhension au CP à la critique littéraire au lycée. Et entre deux, de nombreux exemples au collège et au LP, ainsi qu’en classe d’adaptation, de situations de parole autour des textes qu’on lit mais qu’on ne cherche pas à « commenter ». Une mise au point théorique sur la notion de lecture littéraire.
Parler des textes qui nous parlent (du monde et d’autre chose) en fuyant le commentaire techniciste. De l’apprentissage de la compréhension au CP à la critique littéraire au lycée. Et entre deux, de nombreux exemples au collège et au LP, ainsi qu’en classe d’adaptation, de situations de parole autour des textes qu’on lit mais qu’on ne cherche pas à « commenter ». Une mise au point théorique sur la notion de lecture littéraire.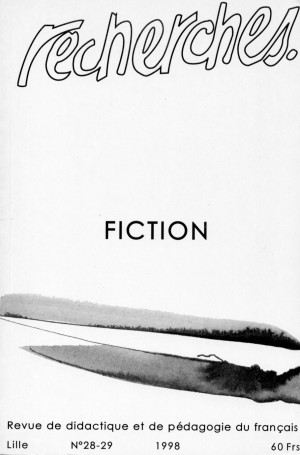 Des relations (paradoxales) entre fiction et réalité, ou comment, en classe, jouer avec (contre ?) le pouvoir des fictions. De nombreuses propositions didactiques (parfois quasi philosophiques) autour de l’écriture de fiction en collège, et d’autres (quasi sociologiques) autour de la lecture de textes fictionnels en LP (dont une nouvelle inédite de P. Boulle). Travail sur l’image en 3e, sur l’élaboration de récits d’énigme, sur la compréhension, en 2nde, de textes reposant sur l’opposition réalité/fiction.
Des relations (paradoxales) entre fiction et réalité, ou comment, en classe, jouer avec (contre ?) le pouvoir des fictions. De nombreuses propositions didactiques (parfois quasi philosophiques) autour de l’écriture de fiction en collège, et d’autres (quasi sociologiques) autour de la lecture de textes fictionnels en LP (dont une nouvelle inédite de P. Boulle). Travail sur l’image en 3e, sur l’élaboration de récits d’énigme, sur la compréhension, en 2nde, de textes reposant sur l’opposition réalité/fiction.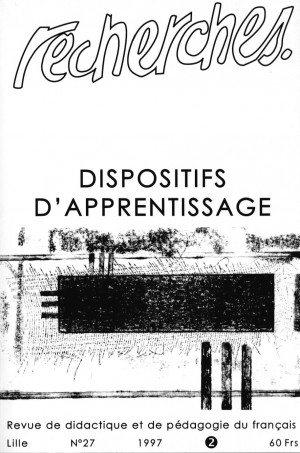 Le détail de la gestion de la classe. Faire classe, c’est d’abord se demander ce qu’auront effectivement à faire les élèves, décider des moyens, des dispositions (matérielles, spatiales, temporelles), des groupements qui faciliteront les apprentissages. Comment mettre les élèves au travail ? Quelles consignes leur donner ? Comment enseigner avec des copies ? Comment faire réfléchir sur le travail, l’école, le travail en groupes, l’écriture ? Des analyses et des propositions didactiques.
Le détail de la gestion de la classe. Faire classe, c’est d’abord se demander ce qu’auront effectivement à faire les élèves, décider des moyens, des dispositions (matérielles, spatiales, temporelles), des groupements qui faciliteront les apprentissages. Comment mettre les élèves au travail ? Quelles consignes leur donner ? Comment enseigner avec des copies ? Comment faire réfléchir sur le travail, l’école, le travail en groupes, l’écriture ? Des analyses et des propositions didactiques.