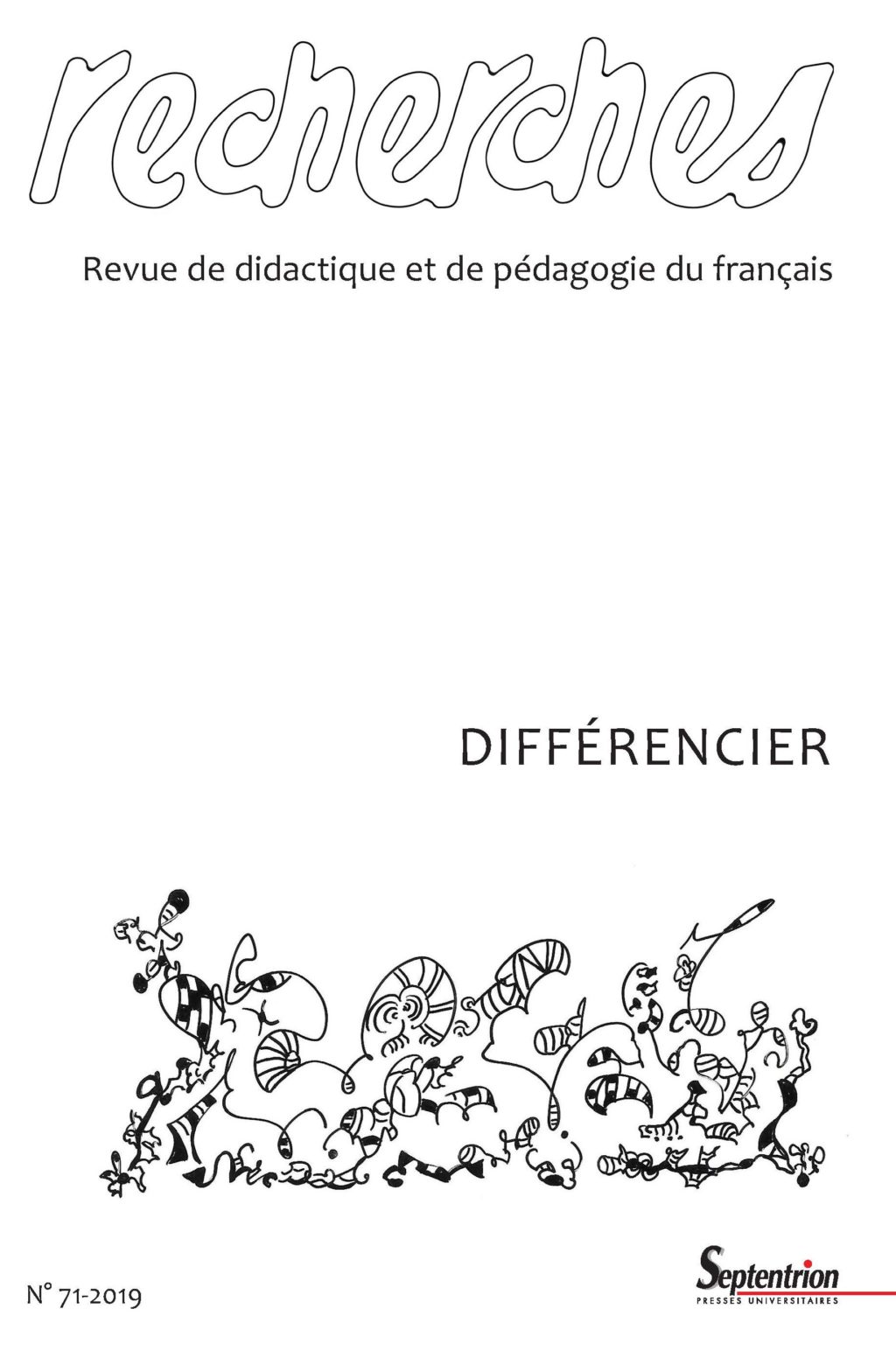
Quel enseignant pourrait affirmer qu’il pratique son métier d’une manière uniforme et immuable, en faisant abstraction du fait qu’aucun élève n’est pareil à un autre, qu’aucun groupe d’élèves n’est pareil à un autre, et que tous n’évoluent pas de la même manière ? Aucun. Mais les évolutions du système éducatif mettent la réflexion sur la différenciation au centre des interrogations professionnelles. Qu’est-ce qu’on différencie ? Sur quels critères ? Selon quelles analyses ? Avec quels dispositifs et outils ? Alors que des injonctions de plus en plus pressantes tendent à transformer l’enseignant en simple exécutant, ce numéro affirme que la différenciation est affaire d’expertise professionnelle et relève de choix pédagogiques et didactiques qu’il s’agit d’élucider.
Le numéro est disponible aux Presses universitaires du Septentrion.
Sommaire
Modéliser la différenciation des situations d’apprentissage dans le cadre de la microculture de classe
Lionel Dechamboux & Lucie Mottier Lopez
Ta pédagogie tu différencieras
Patrice Heems
Perceptions et pratiques de la différenciation pédagogique par les enseignants. De l’enthousiasme aux limites du terrain (ou inversement)
Jonathan Bloch
Madame, on tamponne aujourd’hui ?
Stéphanie Michieletto-Vanlancker
La notion de sujet didactique ou comment les recherches en didactique du français contribuent à penser les différences entre élèves
Isabelle Delcambre
Différencier en orthographe au cycle 3
Séverine Piot
Différencier, diversifier, individualiser ou personnaliser ?
Sylvain Connac
Sortir de l’ordinaire
Myriam Delbecque & Stéphanie Michieletto-Vanlancker
Littératies précoces à l’école maternelle. Différenciation et inégalités
Christophe Joigneaux & Oriane Gélin
Entretien croisé avec des enseignant·e·s de « CP à 12 » : retour sur une année de fonctionnement
Fabienne Bureau, Yannick Dudzinski, Agnès Gilson, Anne Gosset, Marie Hazouard
L’école maternelle publique française à l’épreuve de la pédagogie dite Montessori
Véronique Boiron
Vous avez dit « différencier » ? Mais que fait le formateur ?
Christophe Charlet
Éditorial
Le précédent numéro de Recherches interrogeait les phénomènes de connivence à l’œuvre dans le système éducatif en soulignant leur ambivalence : fondée sur un système de références et de valeurs dont on décrypte ou non les codes, la connivence peut exclure comme inclure. C’est à nouveau d’exclusion et d’inclusion qu’il est question dans ce numéro, centré sur la manière dont l’école prend en compte la diversité des publics qu’elle a mission de former. On le sait, les évolutions du système éducatif, elles-mêmes liées aux évolutions économiques, ont régulièrement conduit, depuis un siècle, à ce qu’on a appelé, selon l’orientation argumentative que l’on donne à son propos, une « massification » ou « démocratisation » de l’enseignement, faisant entrer à l’école ou y maintenant plus longtemps de nouveaux élèves, des élèves non connivents. En témoignent, dans l’histoire récente, les tentatives d’unification du système, de la réforme Berthoin (1959) à l’objectif de 80% d’une classe d’âge au niveau du baccalauréat de Chevènement (1985) en passant par le « collège unique » instauré par la loi Haby (1975). Si cette tendance n’a pas empêché la ségrégation scolaire […]
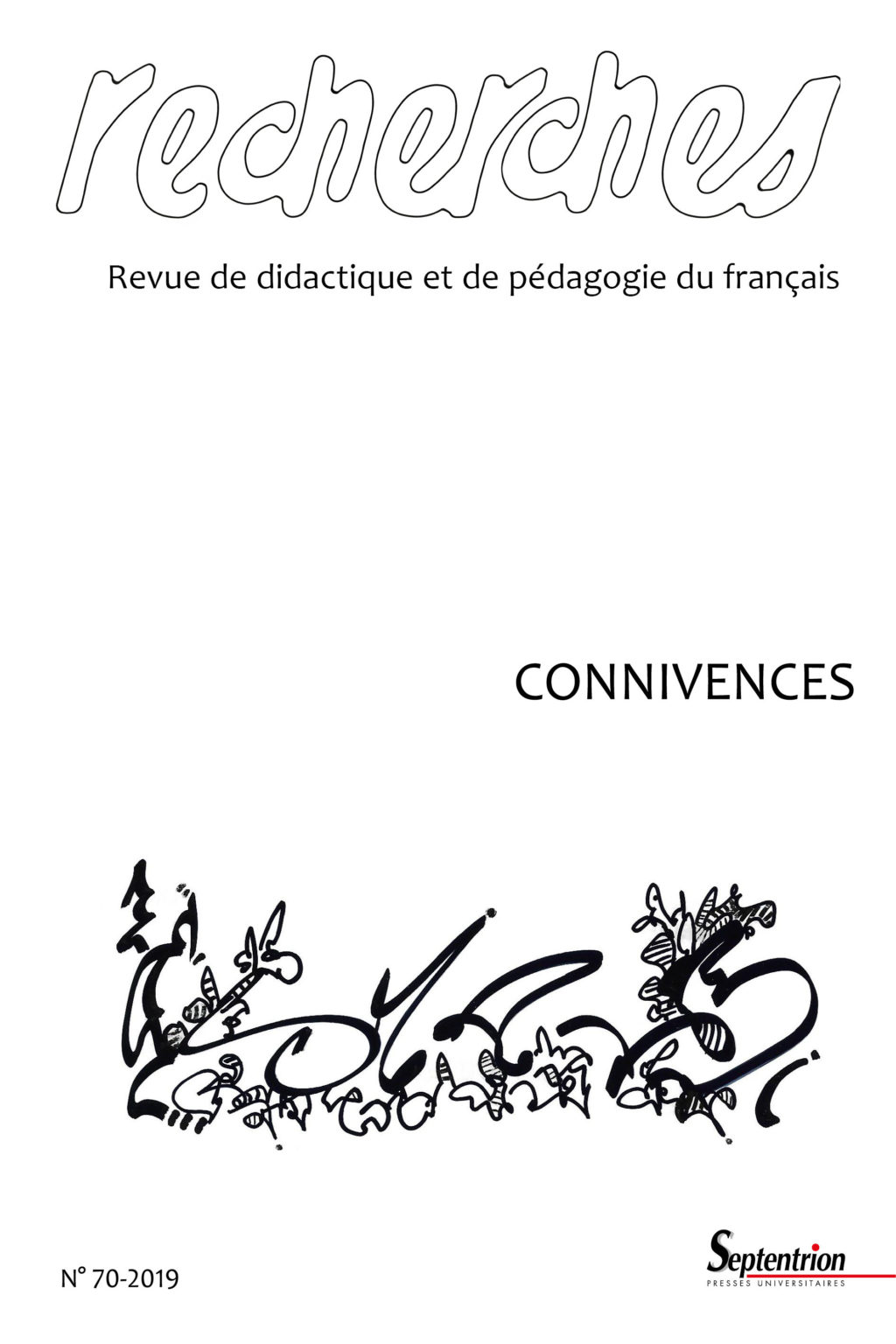
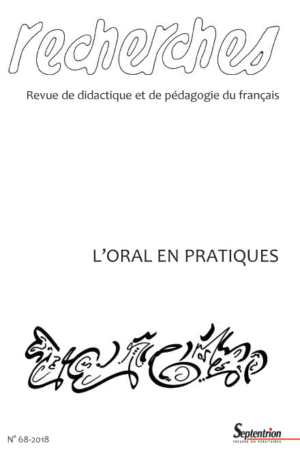 L’oral est abordé dans des situations scolaires inhabituelles à Recherches : les premiers apprentissages en maternelle et les formations en français langue étrangère, deux lieux où il s’agit d’apprendre à parler et à comprendre ce qui se dit. Ces situations spécifiques mettent le doigt sur le fait que l’enseignement de l’oral nécessite, tout au long de la scolarité, la mise en œuvre de dispositifs, de médiations, de détours, voire de ruses.
L’oral est abordé dans des situations scolaires inhabituelles à Recherches : les premiers apprentissages en maternelle et les formations en français langue étrangère, deux lieux où il s’agit d’apprendre à parler et à comprendre ce qui se dit. Ces situations spécifiques mettent le doigt sur le fait que l’enseignement de l’oral nécessite, tout au long de la scolarité, la mise en œuvre de dispositifs, de médiations, de détours, voire de ruses. Le champ disciplinaire du français inclut des savoirs spécifiques (la langue, les discours, la littérature), mais l’enseignant de français, quand il n’est pas lui-même polyvalent (comme dans le premier degré), partage avec d’autres des tâches d’enseignement qui élargissent son champ. Les disciplines se croisent au gré de projets d’équipes, d’opportunités, de partenariats possibles et d’injonctions institutionnelles fluctuantes. Le français est pris dans une nébuleuse de dispositifs qui mettent en œuvre des formes de collaboration interdisciplinaires diverses de par les objectifs visés, les modalités concrètes, les enjeux institutionnels, le degré de facilitation du travail des équipes engagées. Quels apprentissages ces interdisciplinarités favorisent-elles, et à quelles conditions ?
Le champ disciplinaire du français inclut des savoirs spécifiques (la langue, les discours, la littérature), mais l’enseignant de français, quand il n’est pas lui-même polyvalent (comme dans le premier degré), partage avec d’autres des tâches d’enseignement qui élargissent son champ. Les disciplines se croisent au gré de projets d’équipes, d’opportunités, de partenariats possibles et d’injonctions institutionnelles fluctuantes. Le français est pris dans une nébuleuse de dispositifs qui mettent en œuvre des formes de collaboration interdisciplinaires diverses de par les objectifs visés, les modalités concrètes, les enjeux institutionnels, le degré de facilitation du travail des équipes engagées. Quels apprentissages ces interdisciplinarités favorisent-elles, et à quelles conditions ?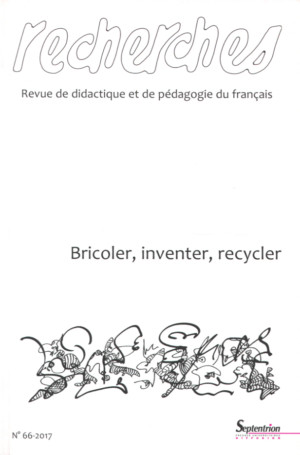 Innovez ! Tel parait être le mot d’ordre institutionnel actuel. Mais ce que l’on baptise « innovation » est-il réellement nouveau ? Et, surtout, les innovations prônées sont-elles gages d’un véritable renouvèlement didactique et pédagogique, prenant en compte les problèmes d’apprentissage ?
Innovez ! Tel parait être le mot d’ordre institutionnel actuel. Mais ce que l’on baptise « innovation » est-il réellement nouveau ? Et, surtout, les innovations prônées sont-elles gages d’un véritable renouvèlement didactique et pédagogique, prenant en compte les problèmes d’apprentissage ?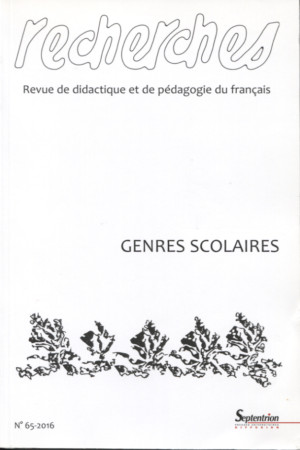 Si le genre est au cœur de l’enseignement du français, ce n’est pas seulement à travers ces objets d’étude que sont les genres littéraires. À l’école, le travail sur les textes est encadré par des modèles qui en régissent la réception et la production. Selon une approche plurielle (didactique du français, analyse du discours et histoire des disciplines), le numéro traite de genres scolaires qui s’enseignent (la dissertation), mais aussi d’outils (les manuels, les questionnaires sur un texte) et d’activités (la récitation) qui gagnent à être pensés comme des genres scolaires, ainsi que de l’usage scolaire, voire de la scolarisation, d’objets extrascolaires (albums pour la jeunesse). Chemin faisant, le numéro explore ainsi la construction scolaire des objets d’enseignement.
Si le genre est au cœur de l’enseignement du français, ce n’est pas seulement à travers ces objets d’étude que sont les genres littéraires. À l’école, le travail sur les textes est encadré par des modèles qui en régissent la réception et la production. Selon une approche plurielle (didactique du français, analyse du discours et histoire des disciplines), le numéro traite de genres scolaires qui s’enseignent (la dissertation), mais aussi d’outils (les manuels, les questionnaires sur un texte) et d’activités (la récitation) qui gagnent à être pensés comme des genres scolaires, ainsi que de l’usage scolaire, voire de la scolarisation, d’objets extrascolaires (albums pour la jeunesse). Chemin faisant, le numéro explore ainsi la construction scolaire des objets d’enseignement.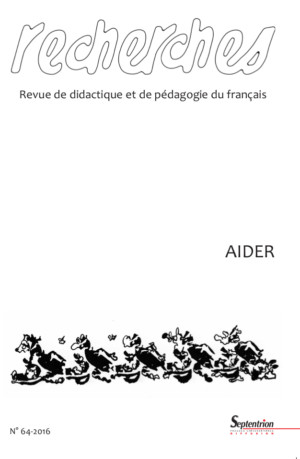 L’aide est une dimension constitutive du métier d’enseignant : enseigner, c’est aider à apprendre. Pour aider, l’enseignant est tantôt dans l’anticipation, tantôt dans l’immédiateté : en amont du cours, il identifie ce qui peut faire obstacle aux apprentissages et imagine des facilitations ; au quotidien, dans les interactions avec les élèves, il réagit, reconstruit, adapte ses démarches. Mais « aider » est aussi un mot d’ordre institutionnel, qui se traduit par la mise en place de dispositifs multiples dont la pertinence ne va pas de soi. À travers des situations concrètes, les articles parcourent ces différentes dimensions de l’aide, pour comprendre ce qui permet la construction de cette professionnalité et ce qui la freine.
L’aide est une dimension constitutive du métier d’enseignant : enseigner, c’est aider à apprendre. Pour aider, l’enseignant est tantôt dans l’anticipation, tantôt dans l’immédiateté : en amont du cours, il identifie ce qui peut faire obstacle aux apprentissages et imagine des facilitations ; au quotidien, dans les interactions avec les élèves, il réagit, reconstruit, adapte ses démarches. Mais « aider » est aussi un mot d’ordre institutionnel, qui se traduit par la mise en place de dispositifs multiples dont la pertinence ne va pas de soi. À travers des situations concrètes, les articles parcourent ces différentes dimensions de l’aide, pour comprendre ce qui permet la construction de cette professionnalité et ce qui la freine.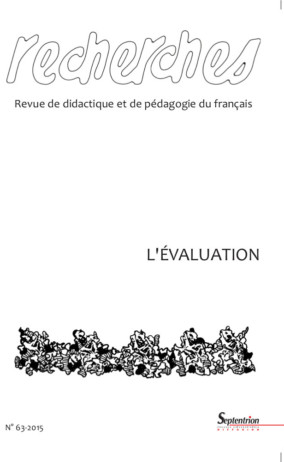 Enseigner et évaluer vont de pair pour l’enseignant. Mais ses pratiques en la matière sont doublement encadrées par l’institution : par les instruments d’évaluation nationaux et internationaux, mais aussi par les prescriptions en matière d’évaluation, associées aux nouveaux dispositifs et programmes. Cette double intervention laisse souvent l’enseignant déconcerté face à des tâches mal définies, comme l’évaluation des compétences. D’où le parti pris d’interroger les présupposés et enjeux de ces instruments et prescriptions, et de continuer de proposer des démarches qui rendent l’élève conscient de ses apprentissages.
Enseigner et évaluer vont de pair pour l’enseignant. Mais ses pratiques en la matière sont doublement encadrées par l’institution : par les instruments d’évaluation nationaux et internationaux, mais aussi par les prescriptions en matière d’évaluation, associées aux nouveaux dispositifs et programmes. Cette double intervention laisse souvent l’enseignant déconcerté face à des tâches mal définies, comme l’évaluation des compétences. D’où le parti pris d’interroger les présupposés et enjeux de ces instruments et prescriptions, et de continuer de proposer des démarches qui rendent l’élève conscient de ses apprentissages.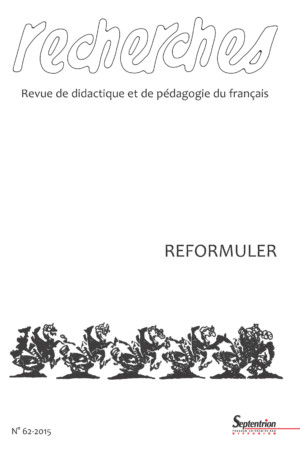 La reformulation est essentielle à l’acte pédagogique, aussi bien dans l’élaboration du savoir à enseigner que dans la préparation de ses cours par l’enseignant, dans le discours de l’élève ou dans les interactions au sein de la classe… La reformulation, qu’elle soit orale ou écrite, qu’elle concerne un énoncé écrit ou oral, est une nécessité pour faire vivre au sein d’une classe, dans un contexte constamment renouvelé, les savoirs et les discours. Cette livraison de Recherches veut interroger les différentes formes de reformulation que la classe de français fait vivre : il s’agit, en somme, de décliner la reformulation et d’en montrer toutes les facettes. Dans les activités proposées dans ce numéro, la reformulation est un moyen d’entrer dans les textes et dans les activités de la classe.
La reformulation est essentielle à l’acte pédagogique, aussi bien dans l’élaboration du savoir à enseigner que dans la préparation de ses cours par l’enseignant, dans le discours de l’élève ou dans les interactions au sein de la classe… La reformulation, qu’elle soit orale ou écrite, qu’elle concerne un énoncé écrit ou oral, est une nécessité pour faire vivre au sein d’une classe, dans un contexte constamment renouvelé, les savoirs et les discours. Cette livraison de Recherches veut interroger les différentes formes de reformulation que la classe de français fait vivre : il s’agit, en somme, de décliner la reformulation et d’en montrer toutes les facettes. Dans les activités proposées dans ce numéro, la reformulation est un moyen d’entrer dans les textes et dans les activités de la classe.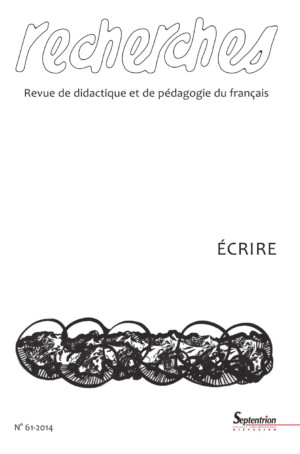 Commencer à écrire, apprendre à écrire et à réécrire, continuer d’apprendre à écrire, écrire pour apprendre : l’« écrire » comme processus est au centre de ce numéro. Les articles s’intéressent aux apprentissages multiples corrélés à l’écriture. Écrire à l’école, c’est, entre autres, mettre en jeu des postures disciplinaires. Du côté de l’enseignement, concevoir des démarches d’apprentissage suppose de prendre en compte la complexité du processus et d’en assumer les tensions et paradoxes. Par exemple celui-ci : si l’écriture réussie est une écriture investie, comment aider les élèves à investir des écrits qui doivent avant tout répondre à des normes scolaires ? Ces questions, et d’autres, se posent et se travaillent à tous les niveaux, des premières classes élémentaires à l’université.
Commencer à écrire, apprendre à écrire et à réécrire, continuer d’apprendre à écrire, écrire pour apprendre : l’« écrire » comme processus est au centre de ce numéro. Les articles s’intéressent aux apprentissages multiples corrélés à l’écriture. Écrire à l’école, c’est, entre autres, mettre en jeu des postures disciplinaires. Du côté de l’enseignement, concevoir des démarches d’apprentissage suppose de prendre en compte la complexité du processus et d’en assumer les tensions et paradoxes. Par exemple celui-ci : si l’écriture réussie est une écriture investie, comment aider les élèves à investir des écrits qui doivent avant tout répondre à des normes scolaires ? Ces questions, et d’autres, se posent et se travaillent à tous les niveaux, des premières classes élémentaires à l’université.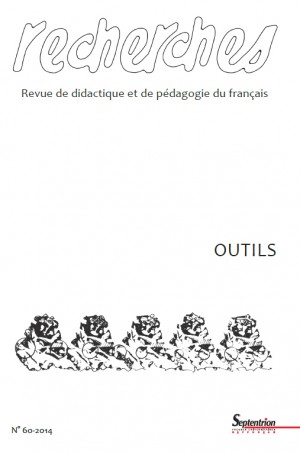 Révolution numérique oblige, la notion d’outil est souvent associée aux outils informatiques, TBI, Web social, plateformes d’enseignement à distance etc. Mais, du crayon au manuel, ce numéro de Recherches s’intéresse aussi aux outils traditionnels et aux outils conceptuels propres à l’enseignement du français. Il interroge les interactions enseignants/outils/élèves à tous les niveaux de la scolarité, de l’école à l’Université. Il s’agit notamment de se demander en quoi les besoins didactiques amènent à privilégier tel ou tel outil, et pour quels usages, et en quoi l’outil lui-même peut induire – ou non – une posture d’enseignement différente. Sans oublier la question de l’appropriation de l’outil – qu’il soit issu de la sphère scolaire ou extrascolaire – par l’enseignant comme par l’élève.
Révolution numérique oblige, la notion d’outil est souvent associée aux outils informatiques, TBI, Web social, plateformes d’enseignement à distance etc. Mais, du crayon au manuel, ce numéro de Recherches s’intéresse aussi aux outils traditionnels et aux outils conceptuels propres à l’enseignement du français. Il interroge les interactions enseignants/outils/élèves à tous les niveaux de la scolarité, de l’école à l’Université. Il s’agit notamment de se demander en quoi les besoins didactiques amènent à privilégier tel ou tel outil, et pour quels usages, et en quoi l’outil lui-même peut induire – ou non – une posture d’enseignement différente. Sans oublier la question de l’appropriation de l’outil – qu’il soit issu de la sphère scolaire ou extrascolaire – par l’enseignant comme par l’élève.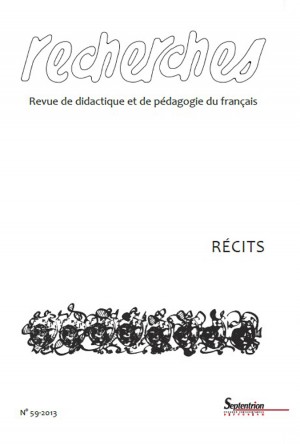 Les récits sont partout à l’école, et ce bien au-delà de la discipline « français », tout en résistant aux définitions : qu’il soit au singulier ou au pluriel, les contours scolaires de l’objet restent flous et même fluctuent. Ce numéro de Recherches part donc d’une définition minimale : faire un récit, c’est raconter une histoire, à l’écrit, à l’oral voire en images. Et il explore quelques implications didactiques, à plusieurs niveaux scolaires et en formation d’enseignants, qu’il s’agisse de développer la connaissance des récits ou d’apprendre par des récits. En essayant de ne jamais oublier, dans les démarches proposées ni les analyses envisagées, qu’il y a aussi du plaisir à inventer ou entendre des récits.
Les récits sont partout à l’école, et ce bien au-delà de la discipline « français », tout en résistant aux définitions : qu’il soit au singulier ou au pluriel, les contours scolaires de l’objet restent flous et même fluctuent. Ce numéro de Recherches part donc d’une définition minimale : faire un récit, c’est raconter une histoire, à l’écrit, à l’oral voire en images. Et il explore quelques implications didactiques, à plusieurs niveaux scolaires et en formation d’enseignants, qu’il s’agisse de développer la connaissance des récits ou d’apprendre par des récits. En essayant de ne jamais oublier, dans les démarches proposées ni les analyses envisagées, qu’il y a aussi du plaisir à inventer ou entendre des récits.