Tous les articles par Marie-Michèle Cauterman
Barthélémy Annie
Bart Daniel
Barrère Anne
Azria Fanny
Audoin-Latourte Nicole
Aeby Daghé Sandrine
N° 65 – Genres scolaires et genres scolarisés en écriture et pratiques sociales de référence. Le cas de l’école primaire en Suisse romande (1830-2010)
N° 73 – Coconstruire le système récit-personnages : un genre d’activité scolaire oral au service de la compréhension d’albums de littérature de jeunesse
Adam Jean-Michel
Paolacci Véronique
Bureau Fabienne
N° 57 – Le quoi de neuf : un lieu où l’enfant devient élève, où l’objet du quotidien entre dans le monde scolaire
N° 60 – Le plan de travail, un outil d’individualisation
N° 62 – Tu parles, j’écris ce que tu dis
N° 68 – Accompagner les consignes orales par des aides visuelles dans l’enseignement spécialisé
N° 71 – Entretien croisé avec des enseignant·e·s de « CP à 12 » : retour sur une année de fonctionnement
N° 74 – L’écriture tâtonnée dans une classe de maternelle
N° 77 – Monographie d’un élève de la maternelle au lycée
N° 67 – INTERDISCIPLINARITÉS
 Le champ disciplinaire du français inclut des savoirs spécifiques (la langue, les discours, la littérature), mais l’enseignant de français, quand il n’est pas lui-même polyvalent (comme dans le premier degré), partage avec d’autres des tâches d’enseignement qui élargissent son champ. Les disciplines se croisent au gré de projets d’équipes, d’opportunités, de partenariats possibles et d’injonctions institutionnelles fluctuantes. Le français est pris dans une nébuleuse de dispositifs qui mettent en œuvre des formes de collaboration interdisciplinaires diverses de par les objectifs visés, les modalités concrètes, les enjeux institutionnels, le degré de facilitation du travail des équipes engagées. Quels apprentissages ces interdisciplinarités favorisent-elles, et à quelles conditions ?
Le champ disciplinaire du français inclut des savoirs spécifiques (la langue, les discours, la littérature), mais l’enseignant de français, quand il n’est pas lui-même polyvalent (comme dans le premier degré), partage avec d’autres des tâches d’enseignement qui élargissent son champ. Les disciplines se croisent au gré de projets d’équipes, d’opportunités, de partenariats possibles et d’injonctions institutionnelles fluctuantes. Le français est pris dans une nébuleuse de dispositifs qui mettent en œuvre des formes de collaboration interdisciplinaires diverses de par les objectifs visés, les modalités concrètes, les enjeux institutionnels, le degré de facilitation du travail des équipes engagées. Quels apprentissages ces interdisciplinarités favorisent-elles, et à quelles conditions ?
Le numéro est disponible aux Presses Universitaires du Septentrion.
Sommaire
Ce que les murs de ma classe disent de mes pas de côté disciplinaires au lycée / Catherine Mercier 7
Laisser la porte ouverte / Stéphanie Michieletto-Vanlancker 31
Le Grand Graveur et les petits enfants, ou tel est appris qui croyait apprendre / Patrice Heems 47
L’espace interdisciplinaire entre la discipline « français » et l’éducation artistique et culturelle / Jean-Charles Chabanne 63
L’atelier slam comme exemple de collaboration entre le français langue maternelle et l’anglais langue étrangère / Catherine Gendron 93
De différentes formes d’interdisciplinarité dans les programmes de collège / Isabelle Delcambre, Marie-Michèle Cauterman 109
EPI quoi encore ? / Sophie Dziombowski, Malik Habi, Stéphanie Michieletto-Vanlancker 141
Interdidactique et didactique du français : quels (r)apports ? quels enjeux ? / Nicole Biagioli 163
Interdisciplinarité choisie : trois disciplines autour de l’oral / Sophie Dziombowski 201
Regards croisés sur un dispositif de formation pluridisciplinaire / Pierre Carion, Christophe Charlet 211
Des nouvelles du livre pour la jeunesse : terrorisme (volet 2) / Élizabeth Vlieghe 223
Éditorial
Entre 2002, date de publication du numéro n° 37 de Recherches, Français et interdisciplinarité, et aujourd’hui, l’injonction interdisciplinaire s’est faite plus aigüe, elle s’impose à l’enseignant de manière à la fois plus intense mais aussi parfois plus douloureuse. Dans l’éditorial du n° 37, le comité de rédaction revenait sur le caractère protéiforme de la discipline « français » et sur la difficulté, déjà ancienne à l’époque, de trouver une cohérence entre les différents champs qu’elle recouvre. Il revendiquait la volonté de s’emparer de certains dispositifs visant à encourager l’interdisciplinarité (comme les travaux personnels encadrés ou les itinéraires de découverte), mais aussi de promouvoir un travail interdisciplinaire volontaire et autonome, dont la logique viendrait des nécessités de l’apprentissage. Il s’interrogeait enfin sur les conditions nécessaires pour qu’ouvrir la discipline et la classe au monde extérieur permette aux élèves de progresser, dans une conception large de l’interdisciplinarité. Ces trois dimensions sont présentes dans ce nouveau numéro, mais il semble qu’un travail difficile soit devenu indispensable pour assurer leur articulation. […]
N° 63 – L’ÉVALUATION
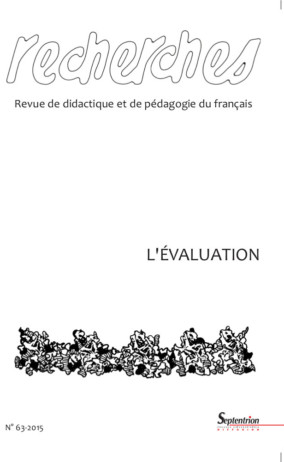 Enseigner et évaluer vont de pair pour l’enseignant. Mais ses pratiques en la matière sont doublement encadrées par l’institution : par les instruments d’évaluation nationaux et internationaux, mais aussi par les prescriptions en matière d’évaluation, associées aux nouveaux dispositifs et programmes. Cette double intervention laisse souvent l’enseignant déconcerté face à des tâches mal définies, comme l’évaluation des compétences. D’où le parti pris d’interroger les présupposés et enjeux de ces instruments et prescriptions, et de continuer de proposer des démarches qui rendent l’élève conscient de ses apprentissages.
Enseigner et évaluer vont de pair pour l’enseignant. Mais ses pratiques en la matière sont doublement encadrées par l’institution : par les instruments d’évaluation nationaux et internationaux, mais aussi par les prescriptions en matière d’évaluation, associées aux nouveaux dispositifs et programmes. Cette double intervention laisse souvent l’enseignant déconcerté face à des tâches mal définies, comme l’évaluation des compétences. D’où le parti pris d’interroger les présupposés et enjeux de ces instruments et prescriptions, et de continuer de proposer des démarches qui rendent l’élève conscient de ses apprentissages.
Ce numéro est disponible aux Presses Universitaires du Septentrion.
Sommaire
Peut-on évaluer les compétences scolaires ? / Bernard Rey 9
Mes classes sans notes / Stéphanie Michieletto-Vanlancker 23
Les évaluations nationales : un « outil » insaisissable ? / Daniel Bart 51
Enseignement d’exploration en seconde générale : et si on n’évaluait pas… / Catherine Mercier 73
Cette affiche-là, on n’en a plus besoin / Sophie Dziombowski 93
L’« assessment » à l’université aux États-Unis : compétences, évaluation, amélioration / Christiane Donahue 101
Oui, on peut / Patrice Heems 111
L’autoévaluation, une aide à l’écriture / Séverine Piot 117
Musées portatifs : une activité personnelle dans le cadre de l’épreuve orale de français / Sophie Gintzburger 129
Un plaisir à livre ouvert ? L’évaluation du plaisir de lire dans le PISA / Daniel Bart, Bertrand Daunay 147
Des nouvelles du livre pour la jeunesse : rêve ou cauchemar (2) / Élizabeth Vlieghe 163
Éditorial
Que Recherches propose un nouveau numéro sur l’évaluation, après les numéros 6 (1987), 21 (1994) et 38 (2003), est l’indice de la récurrence d’une question qui traduit cependant un rythme de réflexion bien différent de l’agitation médiatique (sur les blogs, les forums, dans la presse) et de la précipitation institutionnelle (projets, arrêtés, décrets, conférences) qui ont fait récemment de l’évaluation une question d’actualité : va-t-on supprimer les notes ? Les compétences vont-elles remplacer les connaissances dans les livrets scolaires ? Va-t-on préférer le contrôle continu au Brevet des collèges ? Que nous disent les résultats des enquêtes nationales et internationales sur la santé de notre système scolaire ? […]
Ce que Le Café Pédagogique dit de ce numéro dans son Expresso du 11 janvier 2016…