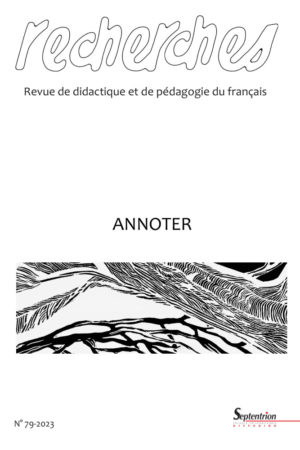Le numéro décline différentes approches de la lecture au fil de la scolarité, de la maternelle à l’enseignement supérieur en passant par les élèves allophones. Depuis les difficultés de l’apprentissage du code et le questionnement des préconisations officielles jusqu’à la délicate question du sens donné à la lecture, le numéro présente de multiples démarches collaboratives ou ludiques ainsi que des analyses théoriques.
Le numéro est disponible aux Presses universitaires du Septentrion.
Sommaire
Facile à lire, impossible à comprendre
Patrice Heems
Planifier l’étude du code alphabétique
Jérôme Riou
Le kamishibaï, de la lecture d’albums à l’art oratoire
Florence Jenner Metz
Lire-écrire-dessiner à partir de poèmes. Quelques propositions pour renouveler l’enseignement de la poésie à l’école élémentaire
Laurence Schneider Bertonnier Rosaz
Les 7-15 ans et la lecture de bandes dessinées : enjeux socioculturels et questions pour l’école
Hélène Raux
Lire un extrait
Coopérer pour lire et écrire
Caroline Fagniard
Le forum de lecteurs : lire et interpréter une œuvre littéraire en collaboration
Chloé Sauvaget
Pour un apprentissage légitime de la lecture dans l’enseignement supérieur. Exploiter les interactions et ruptures littéraciques
Marie-Christine Pollet
L’entrée dans l’univers romanesque grâce à un dispositif ludique : un escape game au service de Balzac
Lucie Péronne
« Néron, c’est Emma ! » : parcours d’une lecture ludique de Britannicus de Racine
Claire Augé
Différencier les pratiques de lecture avec les élèves allophones
Julie Prévost
Trois regards sur un dispositif
Patrice Heems, Stéphanie Michieletto-Vanlancker, Séverine Piot
Lire un extrait
Éditorial
En 2024, Recherches a 40 ans, un bel âge pour une revue associative. Ce
numéro 80 fait d’ailleurs écho au numéro 1 qui était, lui aussi, consacré à la
lecture (que l’on disait déjà en crise) et qui affichait la ligne éditoriale de la
revue : « tenir à distance les passions et les modes » et « se poser la question
du sens que l’élève peut mettre dans [les] apprentissages ». Depuis lors,
nombreux ont été les numéros consacrés à la lecture, explorant les multiples
facettes d’un apprentissage au cœur de l’enseignement du français – sans
perdre de vue cet engagement militant à proposer et analyser des démarches
qui fassent sens, au regard de la recherche et de l’expérience professionnelle.
Les Pratiques de lecture abordées dans ce numéro n’échappent pas à la
règle.
Certaines contributions abordent ainsi la question de l’apprentissage du
code. Les injonctions officielles actuelles en la matière posent problème à
plus d’un titre. En mettant l’accent sur le déchiffrage et la vitesse de lecture
(la fameuse fluence), elles laissent de côté, comme le souligne R. Goigoux,
deux facteurs essentiels : la prosodie (certes plus difficile à évaluer) et la
compréhension qu’elle révèle. Le « guide orange », manifeste pseudoscientifique
des préconisations officielles a, par ailleurs, un impact sur la
confiance en l’école (tout est fait pour véhiculer auprès du grand public
l’idée d’une crise de la lecture, somme toute relative) et sur le métier lui-même.
Les enseignants sont priés de s’exécuter, de privilégier ce qui se
déchiffre aisément à ce qui a du sens et de choisir un manuel homologué. On
est bien loin de la professionnalisation du métier d’enseignant, raison d’être
d’une revue comme la nôtre, qui met en avant la nécessaire diversité des
pratiques et des outils didactiques. Il sera donc question dans ce numéro des
aberrations auxquelles peuvent conduire ces méthodes imposées, notamment
dans les manuels en pleine course à la labellisation. Apprendre à lire, est-ce
vraiment apprendre à lire n’importe quoi ? au risque d’ailleurs que l’élève
s’habitue à ne pas comprendre ce qu’il saura (ou pas) déchiffrer (vite de
préférence) ? D’autant que le temps manque pour un apprentissage de la
compréhension, pourtant essentiel et complémentaire de celui plus
mécanique du code.
Mais les pratiques de lecture ne s’arrêtent pas à la question du
déchiffrage, et l’essentiel des contributions du numéro s’intéresse également
à la socialisation de la lecture et au sens que peuvent lui donner les élèves.
Qu’elle soit faite par eux ou par l’adulte, qu’elle porte sur des poèmes ou des
albums, des extraits ou des œuvres complètes, il s’agit de l’accompagner. Il
est essentiel en effet de ne tenir aucune lecture comme évidente ou allant de
soi, qu’il s’agisse des « classiques », de la littérature pour la jeunesse, de la
bande-dessinée ou de discours scientifiques. Les démarches proposées
tiennent compte de cet impératif. Elles sont pour la plupart collaboratives
(créer un kamishibaï, participer à un forum des lecteurs par exemple) et
parfois présentées comme ludiques (jeu de rôle ou escape game), non pas
qu’elles ne seraient pas « scolaires » (l’école est par définition le lieu du
« scolaire » et des apprentissages), mais en tant qu’elles constituent des
facilitateurs pour donner du sens à la tâche scolaire et entrer dans l’œuvre.
Réfléchir à un tel angle d’approche, c’est, en tout cas, faire le « jeu » de la
socialisation de la lecture, ouvrir le cercle de la connivence culturelle, duquel
l’élève peut vite se sentir exclu. Et le rôle de l’école est bien de ne pas faire
de la lecture une pratique discriminante. En ce sens, les dispositifs comme
celui du « quart d’heure de lecture » courent le risque d’être contreproductifs
lorsque leur mise en œuvre est imposée par l’institution. Ils prennent tout
leur sens, en revanche, s’ils sont choisis puis adaptés par le professionnel
qui, à l’aune de son expérience, juge ce rituel utile pour sa classe et fait en
sorte qu’il le soit.
La variété des articles présentés dans ce numéro est constitutive d’un
objet d’enseignement tentaculaire et reflète la diversité des approches
possibles en matière de lecture. En quarante ans, les instructions officielles
ont suivi le cours capricieux et volatile des politiques éducatives, la
recherche dans le champ de la didactique du français s’est développée, les
outils technologiques se sont multipliés, les offres en matière d’édition se
sont élargies (le marché est porteur) mais les difficultés que posent
l’apprentissage et la maitrise de la lecture restent les mêmes. Et Recherches
n’a pas fini d’en explorer les contours, modestement, mais avec la même
détermination – loin des passions et des modes – à donner du sens à ce qui se
fait en classe.